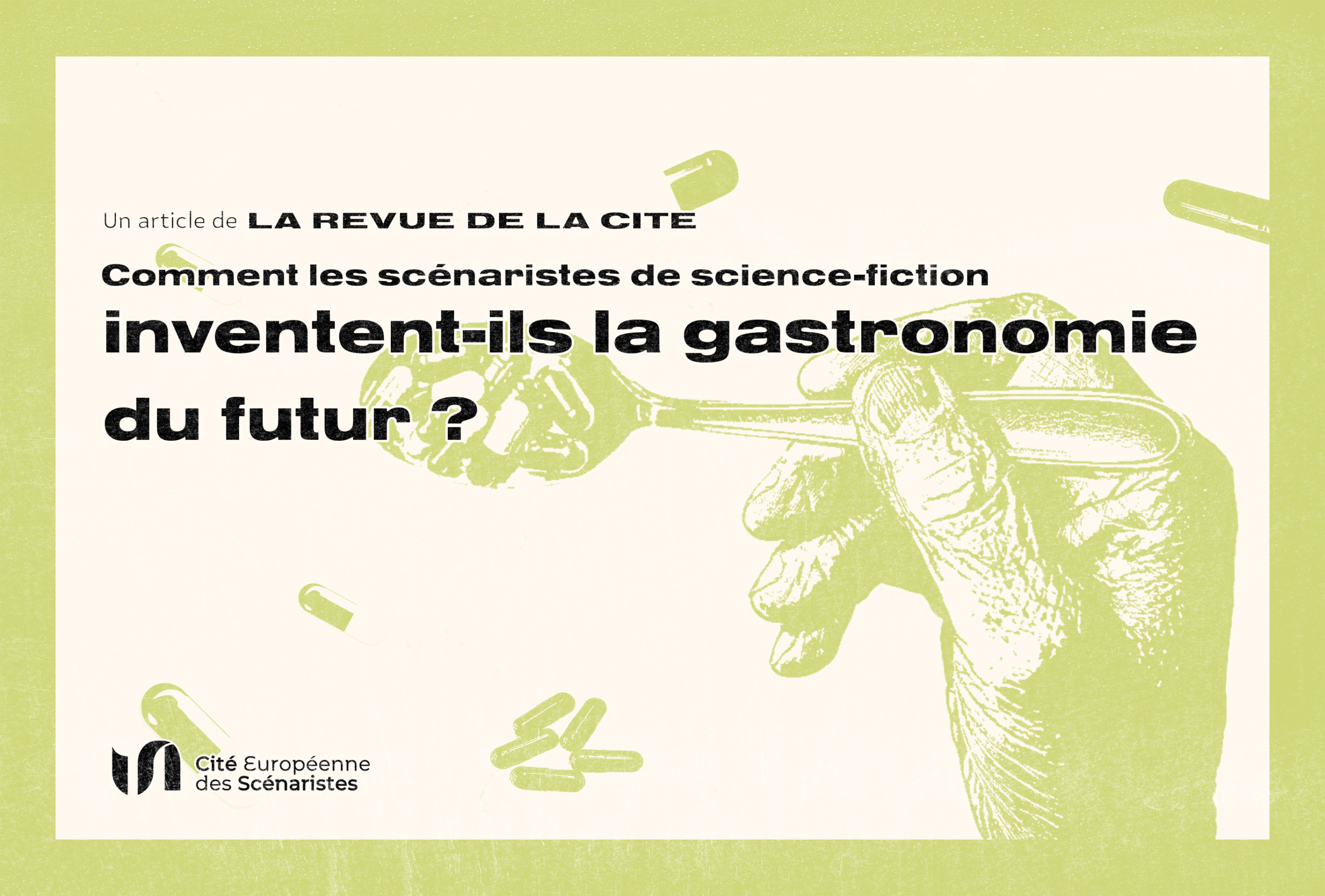Dans les mondes de la science-fiction, la gastronomie sert souvent de catalyseur à l’imagination, proposant des visions de sociétés futures où l’alimentation reflète les innovations technologiques, les enjeux écologiques ou les dynamiques de pouvoir.
Bien plus qu’un simple artefact de décoration en arrière-plan, la représentation de la nourriture du futur contribue activement à l’élaboration des univers, en offrant aux spectateurs un aperçu tangible du quotidien de ces mondes inventés et de ce qu’il y aurait à inventer pour le nôtre.
Premières représentations : Stimuler l’imaginaire par l’exotisme et l’étrangeté, en marquant une rupture
Dans les premières œuvres de science-fiction et de fantasy, la nourriture était souvent utilisée pour souligner l’altérité des mondes imaginés.
Par exemple, dans L’Amour en l’an 2000 (1930), écrit par Buddy G. DeSylva, Lew Brown et Ray Henderson, la nourriture est réduite à des pilules contenant des repas entiers et facilement consommables.
La nourriture sous forme de pilules était une représentation populaire, reflétant les fantasmes de l’époque sur une vie future ‘simplifiée’ par la technologie.
Cette représentation nous raconte deux choses :
- L’objectif était avant tout de déstabiliser le spectateur pour souligner les codes naissants de la science-fiction, introduisant une distance entre le monde représenté à l’écran et celui du quotidien des audiences ;
- Les scénaristes de science-fiction projetaient une vision de l’efficacité maximale où le temps passé à manger est minimisé, libérant l’individu pour d’autres activités.
La nourriture comme outil de contrôle et critique de l’industrialisation
Avec l’avènement de la contre-culture, des mouvements écologistes et de la sensibilisation à la surpopulation croissante de la planète dans les années 1970, les représentations de nourriture dans la science-fiction se complexifient.
Le film le plus emblématique de cette période et de l’utilisation de la “nourriture du futur” comme représentation de contestation est Soleil Vert (1973).
Ecrit par Stanley R. Greenberg et adapté du roman Make Room! Make Room! (1966) de Harry Harrison, Soleil Vert se déroule dans un monde dystopique surpeuplé et pollué, où la nourriture est fabriquée industriellement et rationnée. Cette “nourriture du futur” symbolise le contrôle extrême du gouvernement sur les ressources, et donc sur la population.
Mais la critique ne s’arrête pas là (spoilers ci-dessous).
La révélation finale du film est que ces plaquettes sont en fait composées de restes humains, ce qui souligne la déshumanisation et la cannibalisation de la société par elle-même sous le poids de la consommation de masse.
Le film critique directement les effets de l’industrialisation sur l’environnement et sur la société, avec une production alimentaire qui symbolise la perte ultime d’humanité – transformer les morts en nourriture pour les vivants.
Autre histoire emblématique de ce mouvement, Le Transperceneige bande-dessinée de 1984 écrite par les Français Jacques Lob, Benjamin Legrand et Olivier Bocquet, et adaptée en 2013 par Bong Joon-ho et Kelly Masterson.
La nourriture y est également un outil de contrôle où seul le strict minimum est alloué aux masses ; des barres protéinées, données aux passagers des wagons arrière par les élites qui habitent l’avant du train. Reprenant le même procédé que Soleil Vert, il sera plus tard révélé que ces barres protéinées sont en fait constituées d’insectes.
Autant de scénarios qui reflètent les inquiétudes contemporaines telles que la surpopulation, la dégradation environnementale, et la déshumanisation par le biais de la technologie et qui utilisent la nourriture comme métaphore de ces problèmes.
Sous la plume des scénaristes de science-fiction des années 70 et 80 les aliments deviennent une métaphore de la manipulation et de l’oppression exercée par les autorités ou les classes dirigeantes ; la lutte pour une nourriture meilleure ou plus abondante devient un acte de rébellion et de résistance.
Une gastronomie d’inventions stimulée par l’environnement technologique naissant (années 80-90)
Dans les années 80 et 90, les scénaristes de science-fiction diversifient leurs représentations de la nourriture en s’inspirant à la fois de leur fascination pour les possibilités naissantes de la biotechnologie, et de leur conscience des enjeux éthiques liés par exemple aux problématiques de pollution, surpopulation ou modifications génétiques.
Avec l’évolution des machines d’électro-ménagers des années 80, promettant de plus en plus d’automatisation, les scénaristes et cinéastes de cette période pousse cette vision à son paroxysme : l’idée d’un repas instantané.
Dans la série télévisée Star Trek: The Next Generation (1987-1994), on peut ainsi découvrir le concept du “réplicateur”, une machine capable de créer de la nourriture sur commande.
Une autre machine, l’Hydrator, est inventée par Robert Zemeckis et Bob Gale à la fin des années 80 pour le scénario de Retour Vers le Futur 2 (1989), qui se déroule en 2015.
Le futur est devenu le présent, et selon un article paru en première page du numéro du 22 octobre 2015 de USA Today, la réhydratation des aliments pourrait provoquer « une augmentation anormale de la pression de l’eau » dans l’hydrateur, et si l’unité était « obstruée ou mal ventilée », une explosion pourrait se produire.
Pas de nom spécifique pour cette machine dans Le Cinquième élément (1997), écrit par Luc Besson et Robert Mark Kamen, mais on retrouve la même innovation culinaire en 2263 avec Leeloo (interprétée par Milla Jovovich) qui se prépare des cuisses de poulet en quelques secondes.
Notre regard sur la nourriture évolue également comme le montre une scène dans Blade Runner (1982), écrit par David Webb Peoples et Hampton Fancher, d’après le roman de Philip K. Dick : alors que la révélation des élites “nourrissant” les classes sociales de barres d’insectes dans Le Transperceneige est purement révoltante, ce même acte de se nourrir par des insectes est quasiment banal dans ce Los Angeles imaginé de 2019. Et dans les faits, en 2013, l’entomophagie, c’est-à-dire la pratique de consommer des insectes, est une habitude alimentaire pour environ 2 milliards de personnes soit 25% à 30% de la population mondiale.
La représentation de la cuisine en science-fiction comme laboratoire de R&D ?
À l’ère de la globalisation et face aux crises écologiques, des films comme Seul sur Mars (2015), écrit par Drew Goddard, traitent de la production alimentaire dans des conditions extrêmes, illustrant notre besoin d’envisager désormais la production alimentaire dans une perspective de survie et d’innovation responsable.
Ode à l’agriculture durable, le film illustre la lutte pour l’autosuffisance alimentaire dans l’environnement hostile de Mars, où Mark Watney (interprété par Matt Damon) réussit à fertiliser le sol avec ses propres déchets, et où la culture de pommes de terre devient la clé de la survie.
Ces visions futuristes de la cuisine en fiction stimulent l’imagination des chefs et des scientifiques d’aujourd’hui, menant à des expérimentations réelles avec la gastronomie moléculaire ou l’impression 3D de nourriture.
C’est par exemple le cas du chef britannique Hestor Blumenthal.
Classé plusieurs fois parmi les meilleurs du monde, est célèbre pour incorporer des éléments de science-fiction dans sa cuisine, tels que l’azote liquide pour la congélation instantanée ou des machines à vapeur pour distiller des saveurs pures.