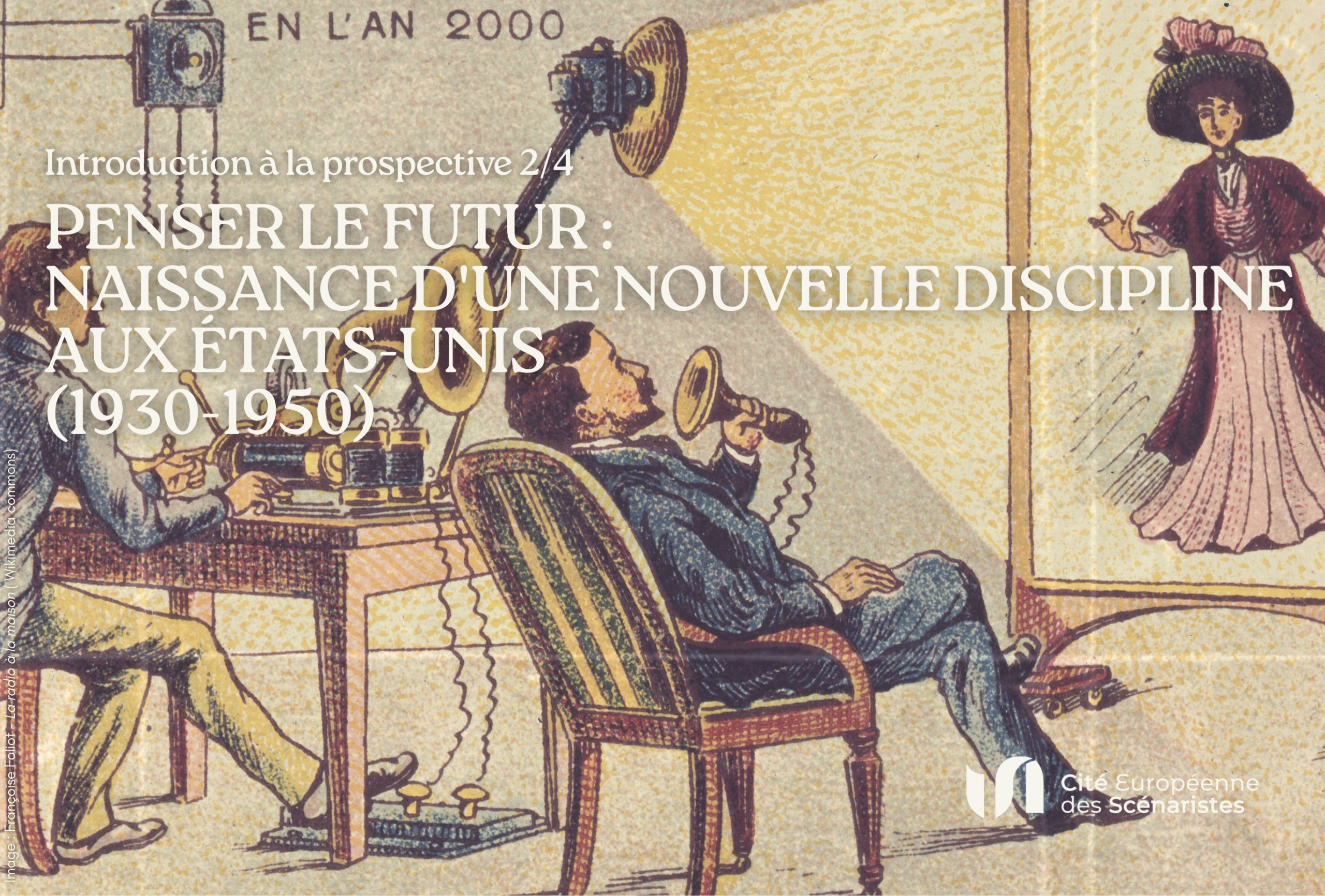Des fondements socio-économiques…
Nous sommes en 1929, alors qu’une bulle spéculative s’est formée sur les marchés financiers. En octobre, le krach boursier de Wall Street précipite brutalement l’économie américaine dans la Grande Dépression, entraînant des faillites bancaires, une chute de la consommation et la ruine de millions d’investisseurs.
C’est dans ce contexte que le président Hoover constitue une Commission spéciale chargée de réaliser un rapport sur les tendances sociales aux États-Unis.
Jacques Theys (docteur en mathématiques et vice-président de la Société française de prospective) explique cette demande par 3 raisons :
“D’abord parce que les Américains éprouvent le besoin de comprendre les causes structurelles de cette crise. Ensuite parce qu’il existe aux Etats-Unis une forte confiance dans la science et la volonté d’appuyer les décisions politiques sur celle-ci. Et enfin, parce que cette préoccupation entre à ce moment-là en résonance avec le développement des approches quantitatives en sciences sociales.”1
Quelques mois plus tard, le président Roosevelt commande une nouvelle étude sur les grandes tendances sociales afin de soutenir les travaux socio-économiques qui mèneront au New Deal de 1933. C’est la naissance des « Future Studies », traduisible en français par le terme « futurologie »;
“Il y a donc à la source de cette naissance de la prospective aux Etats-Unis le souci d’articuler politique et progrès des connaissances scientifiques (notamment en sciences sociales).”
… et militaire
Les « Future Studies » seront rapidement réutilisées pour répondre cette fois à des préoccupations militaires, dès les années 1940.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les besoins stratégiques et d’anticipation sur les technologies futures montent en flèche.
Pour y remédier, de grands travaux de projection sont lancés :
en 1944, l’armée de l’air américaine commande ainsi à l’ingénieur et physicien américano-hongrois Theodore von Kármán une étude afin de “définir l’avenir de la puissance aérienne dans l’après-guerre”.
Dans son livre Global Mission, le général Arnold, commanditaire de cette étude, raconte :
“J’ai dit à ces scientifiques que je voulais qu’ils réfléchissent vingt ans en avant. Je voulais qu’ils pensent à des avions à vitesse supersonique, à des avions qui se déplaceraient et fonctionneraient sans équipage, à l’amélioration des bombes, aux défenses contre les avions modernes et futurs, à la télévision, à la recherche météorologique et médicale, à l’énergie atomique, et toute autre phase de l’aviation qui pourrait affecter le développement de l’industrie aéronautique. J’ai assuré au Dr. von Karman qu’il devait se projeter dans le futur.”
Cette étude de 30 volumes, Towards New Horizons (1947), fait ainsi le pont entre les prévisions futures des avancées de l’ingénierie et leurs potentielles applications dans les futures conflits.
Lors de la mort de Theodore von Kármán, Air Force Magazine lui rend un poignant hommage :
“Le génie hongrois a contribué à façonner un avenir qui n’a jamais dépassé sa propre vision étonnamment illimitée.”
Quel futur au XXIe siècle pour les prospectivistes américains ?
Les « Future Studies » et les enjeux militaires sont encore très liés aux Etats-Unis ; depuis 1997, la CIA publie tous les quatre ans ses Global Trends, son rapport sur les prévisions et les risques du futur :
“Global Trends est conçu pour fournir un cadre analytique aux décideurs politiques au début de chaque administration, alors qu’ils élaborent une stratégie de sécurité nationale et qu’ils naviguent dans un avenir incertain.”2
Le dernier en date, Global Trends 2040 (2021), fait état des prévisions d’un monde de plus en plus instable d’ici 2040, et propose 5 scénarios de futurs possibles :
- Renaissance of Democracies : les États-Unis sont à la tête d’une résurgence des démocraties
- A World Adrift : la Chine est l’État leader mais non l’État dominant au niveau mondial
- Competitive Coexistence : les États-Unis et la Chine prospèrent et se disputent le leadership dans un monde divisé
- Separate Silos : la mondialisation s’effondre et des blocs économiques et de sécurité émergent pour protéger les États contre des menaces croissantes.
- Tragedy and Mobilization : un changement révolutionnaire de bas en haut dans le sillage de crises environnementales mondiales dévastatrices.
Des deux grandes approches dont nous avions parlé dans le précédent article, l’approche américaine de la prospective est celle de “L’école des avenirs tendanciels”. Elle repose sur une analyse et un suivi des tendances et suppose une projection vers l’avenir qui anticipe des déterminismes existants.
La deuxième grande école, celle “du carrefour des avenirs” appelant à une approche beaucoup plus constructive et créative, va être conceptualisée et développée au milieu des années 50 en France sous le nom de « prospective » – et c’est ce que nous verrons dans le prochain article !