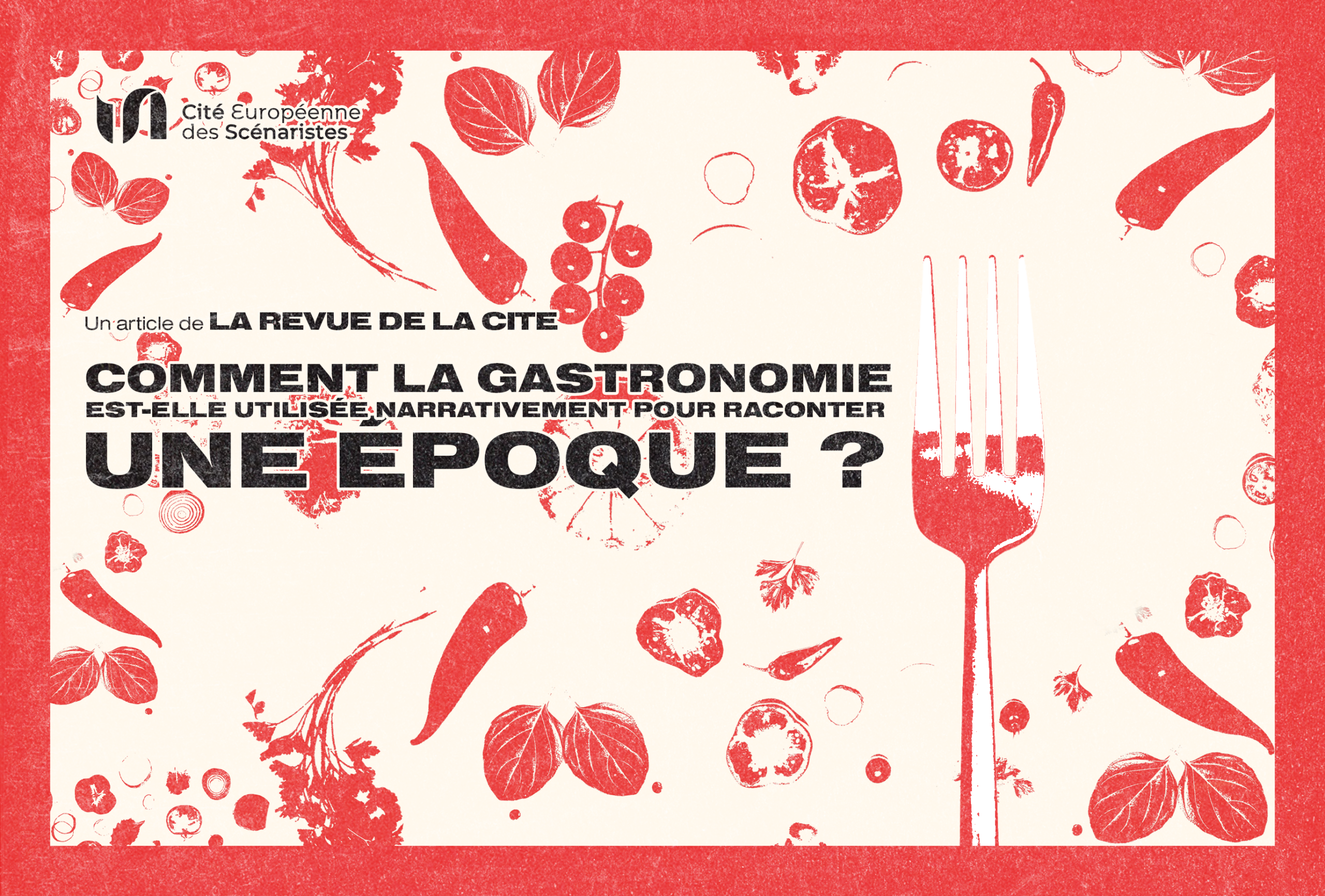Pour raconter une époque et une culture, il y a la représentation des préoccupations sociales, des modes vestimentaires, des décorations d’intérieur… Et de la gastronomie. C’est pourquoi, dans les films historiques, une attention toute particulière est accordée à la réalité de la cuisine de l’époque – à la fois ce qu’on mangeait et de quelle manière.
Pour commencer ce nouveau cycle sur les liens entre Scénario & Gastronomie, voyons comment les scénaristes de films historiques utilisent la gastronomie pour raconter les époques représentées.
L’abondance comme symbole de pouvoir
Si l’on pense aux peplums représentant la Rome antique, un élément se rappelle tout de suite à nous : l’opulence des scènes de banquets. Ces repas somptueux boostés par la technologie du Technicolor symbolisent en un tableau l’opulence, la richesse, et donc le pouvoir de ses protagonistes. Dans ces films, la nourriture n’est pas simplement utilisée pour nourrir ; elle est un outil de spectacle, une démonstration de pouvoir politique, économique et social.
C’est pourquoi les scènes de repas sont donc avant tout utilisées narrativement comme arrière-plan des intrigues politiques où des enjeux cruciaux se jouent entre un verre de vin et une grappe de raisins.
Prenons l’exemple de Cléopâtre (1963), écrit par Joseph L. Mankiewicz, Ranald MacDougall et Sidney Buchman. Au-delà même des intrigues politiques narratives, les scènes de banquets révèlent esthétiquement les complexités sociales et politiques de l’Empire romain.
Les plats servis, allant des fruits de mer aux gâteaux au miel, illustrent la richesse des échanges commerciaux et l’influence des conquêtes romaines sur la cuisine de l’époque. César, en tant que leader, utilise ces occasions pour afficher sa richesse économique, son prestige militaire et son contrôle social, renforçant son statut d’empereur tout puissant.
On retrouve cette même opulence dans La Reine Margot (1994), écrit par Patrice Chéreau et Danièle Thompson. Alors que l’histoire se déroule durant les guerres de religion du XVIème siècle, les fastueux banquets de la cour royale de France offre un spectacle de pouvoir et une scène de séduction politique.
L’utilisation de scènes de banquets et de faste gastronomique comme symbole de pouvoir peut également être retrouvée dans les films historiques comme Marie Antoinette (2006), où Sofia Coppola utilise la nourriture pour symboliser l’extravagance de la cour française juste avant la Révolution française, ou encore The Great Gatsby (2013) où les somptueux buffets dans les fêtes de Gatsby des années 1920 représentent son ascension sociale et sa richesse, utilisés pour impressionner, gagner le respect des élites et masquer ses origines modestes.
L’extravagance et la juxtaposition comme symbole de critique politique
Le faste gastronomique n’est pas qu’un symbole de pouvoir entre puissants ; c’est également un symbole de différenciation avec le peuple et donc une expression de domination. Le contrôle exercé sur ceux qui seront invités à la table reflète et renforce les hiérarchies sociales. Sauf que contrairement aux banquets des peplums ci-dessus, le “spectacle” de l’opulence est nuancé par la juxtaposition avec la pauvreté des moins fortunés, accentuant les inégalités sociales et (parfois) la corruption sous-jacente. Ainsi, le faste n’est plus une démonstration de pouvoir quasi seulement esthétique, mais un étalage d’inhumanité assumée.
On peut par exemple citer Spartacus (1960), écrit par Dalton Trumbo, d’après le roman de Howard Fast, et réalisé par Stanley Kubrick. Contrairement aux autres peplums, les scènes impliquant des banquets romains servent avant tout à mettre en scène la décadence de la République romaine et l’indifférence des aristocrates romains face aux souffrances des esclaves. Une scène célèbre où Laurence Olivier (en Crassus) dîne pendant que des esclaves s’entretuent pour le divertir, lui et ses convives, est particulièrement frappante.

Dans Le Nom de la Rose (1986), écrit par Gérard Brach, Alain Godard, Andrew Birkin et Howard Franklin, d’après le roman éponyme d’Umberto Eco, la nourriture est également utilisée comme critique sociale à plusieurs niveaux.
Le film se déroule dans un monastère du Moyen Âge, où la nourriture symbolise à la fois piété, pénurie et inégalité. Les repas simples et austères des moines contrastent avec les banquets opulents des hauts dignitaires de l’Eglise, faisant de la nourriture un signe extérieur de la corruption interne de l’Eglise. Ainsi, cette simple juxtaposition de représentation de la nourriture révèle les tensions entre les strates hiérarchiques d’une même institution et entre le spirituel et le matériel.
Dans La Reine Margot cité ci-dessus, la nourriture et l’opulence des banquets servent également à illustrer la décadence morale et spirituelle de la cour, en la juxtaposant à la brutalité des massacres de la Saint-Barthélemy.
Plus récemment, ce même procédé est utilisé dans Le Labyrinthe de Pan (2006), écrit et réalisé par Guillermo del Toro. La scène du banquet fastueux du Capitaine, où il mange seul des mets délicats pendant que la guerre ravage le pays, est une représentation glaçante de son indifférence et de sa cruauté.
La gloutonnerie comme symbole de satire sociale
La nourriture et l’acte de se nourrir sont également utilisés de manière satirique, voire provocante, comme critique de la décadence sociale à travers les époques.
Ainsi, Charlot se retrouve dès 1936 à revoir sa manière de se nourrir dans Les Temps modernes. Face à cette “machine à manger” il n’a d’autres choix que d’accepter d’être gavé au bon vouloir de la technologie, qui plus est dysfonctionnelle. Cette scène critique la perte d’humanité et l’absurdité de l’efficience excessive dans les usines et la nourriture symbolise ici le contrôle et la domination exercée par les employeurs sur les travailleurs.
On peut également citer l’adaptation du roman de 1749 de Henry Fielding, Tom Jones (1963), scénarisée par John Osborne et interprétée par Albert Finney. La nourriture et les scènes de repas sont utilisées comme satire sociale pour se moquer des mœurs de la haute société. L’étiquette excessive et les manières prétentieuses lors de ces scènes sont allègrement ridiculisées, critiquant ainsi la superficialité des élites aristocratiques.
Enfin, La Grande Bouffe (1973), écrit par Marco Ferreri, Rafael Azcona et Francis Blanche, est la quintessence de l’utilisation de la nourriture à des fins de critique sociale. La nourriture y est représentée en quantités obscènes, symbolisant la décadence et l’excès des élites. L’idée germe d’ailleurs dans la tête du réalisateur Marco Ferreri au cours des grands dîners organisés par les producteurs Jean-Pierre Rassam et Alain Sarde1.
Les personnages, qui sont tous des hommes aisés et représentants de la haute société, utilisent la nourriture comme moyen de suicide orchestré, critiquant par là même cette société de consommation excessive des années 70 qui cherche toujours plus, sans être jamais satisfaite.
Le partage comme symbole d’expression culturelle
Enfin, la nourriture peut également être représentée comme vecteur de valeurs positives, aux antipodes de La Grande Bouffe ; une manière de tout aussi bien se connecter aux autres qu’à soi-même.
C’est par exemple le cas dans Le Festin de Babette (1987), écrit par Gabriel Axel d’après une nouvelle de Karen Blixen, Babette se sert de la nourriture pour transcender les divisions religieuses et sociales de ce petit village danois du XIXème siècle, utilisant la cuisine française raffinée pour ouvrir les esprits et guérir les vieilles querelles.
On peut également citer le film mexicain Les Epices de la passion (1992), écrit par Laura Esquivel, explore quant à lui comment la cuisine peut être un moyen de ne pas se perdre face aux dogmes. Ce film, dont l’action se déroule au début du XXème siècle pendant la révolution mexicaine, raconte comme Tita, une Mexicaine qui ne peut vivre la vie qu’elle souhaite à cause du poids des traditions, va trouver son émancipation à travers les plats qu’elle cuisine.
Enfin, la nourriture comme moyen ultime de rester en contact avec ses origines malgré le déracinement est un thème souvent exploré au cinéma. On peut par exemple citer Big Night (1996), écrit par Stanley Tucci et Joseph Tropiano.
Le film raconte l’histoire de deux frères italiens, dans les années 1950, qui possèdent un restaurant dans le New Jersey, et qui luttent pour le sauver face à la concurrence d’un établissement moins authentique mais plus prospère. Pour Primo, chaque plat est une œuvre d’art qui représente non seulement ses compétences en tant que chef, mais aussi son identité et son héritage ; les plats qu’il prépare sont chargés de la tradition et des souvenirs de son Italie natale.