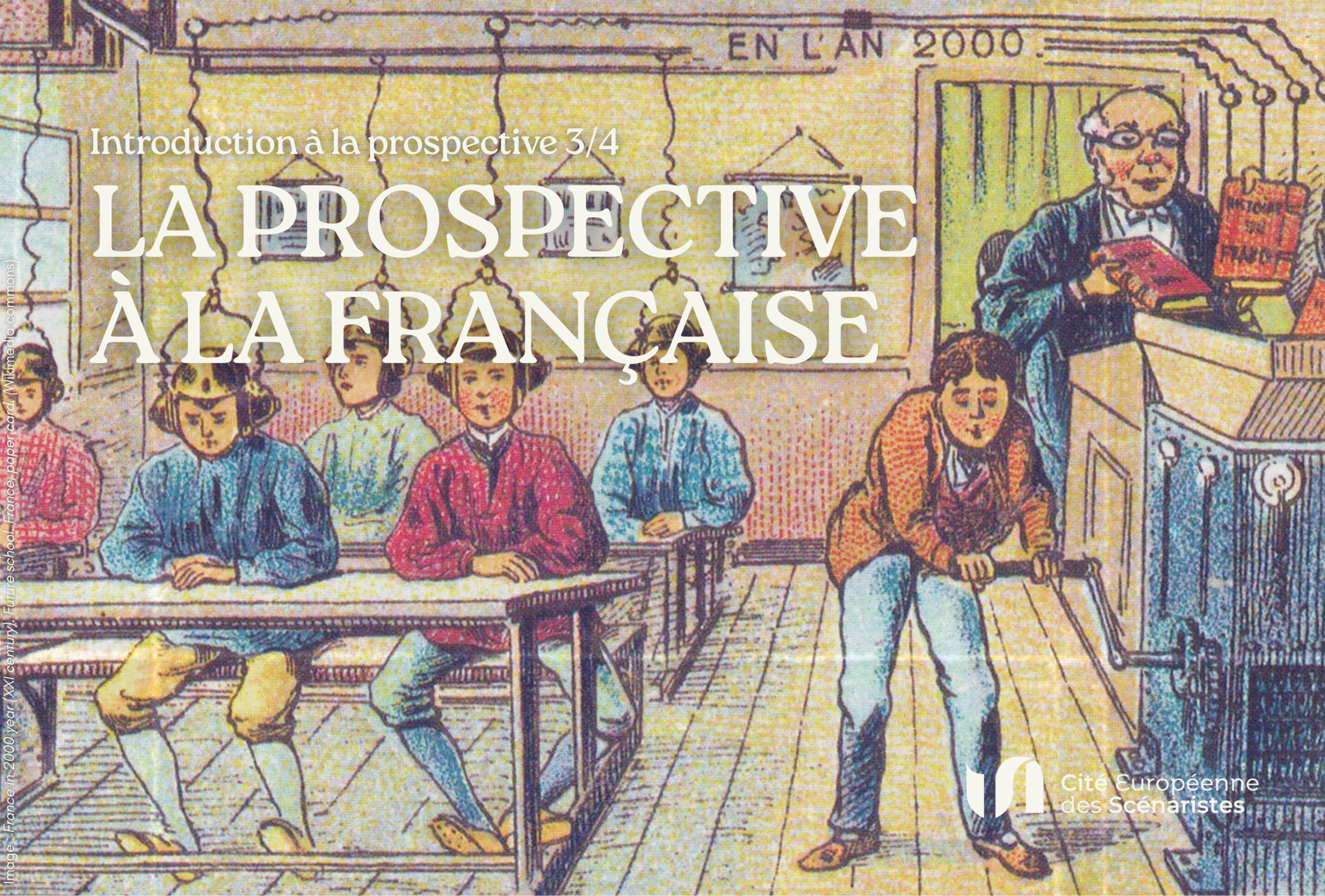Des fondements humanistes & sociaux
Une vingtaine d’années après les premiers travaux de futurologie outre-Atlantique, l’approche française va se conceptualiser dans les années 1950 sous l’impulsion du philosophe Gaston Berger.
En 1957, il définit la prospective comme une manière de réfléchir sur l’avenir. Dans son livre Phénoménologie du temps et prospective (1964), il écrit :
“Avant d’être une méthode ou une discipline, la prospective est une attitude”.
Sa pensée repose sur l’idée qu’il faut “penser à l’homme en fonction d’une nouvelle liberté de choix”1, refusant ainsi tout déterminisme fataliste.
Dans la prospective à la française, l’humanité est maîtresse de son destin.
Contrairement à la prospective américaine, centrée sur la prévision technologique et la gestion des risques pour les décideurs, la prospective « à la française » se caractérise par une vision plus philosophique et humaniste. Elle met l’accent sur l’action collective et la participation des acteurs pour la construction d’un futur souhaitable.
Les 5 fondamentaux de la prospective à la française
Gaston Berger identifie 5 piliers à cette attitude prospective. Les analyses de ces 5 piliers nous viennent de Vincent CALAY, Frédéric CLAISSE, Jean-Luc GUYOT, et de Rafaël RITONDO2 :
- Voir Loin : “Les changements de notre monde sont de plus en plus nombreux et rapides et les causes engendrent leurs effets à une vitesse de plus en plus élevée. Il n’est donc plus possible de considérer simplement les conséquences immédiates des actions en cours. Dès lors, la prospective nous invite à considérer l’avenir et à le considérer au loin. Elle est l’étude de l’avenir lointain”
- Voir Large : “Pour anticiper une situation éloignée dans l’avenir, il faut privilégier l’interdisciplinarité et la transversalité. Elle s’appuie sur l’intelligence collective, sur la confrontation de savoirs et d’expériences et sur l’imagination pour dégager une vision commune”
- Voir Profond : “Les mutations impliquent une analyse en profondeur des processus à l’œuvre, des tendances, des ruptures… C’est pourquoi la prospective ne peut procéder que par un long travail d’analyse en profondeur”
- Prendre des Risques : “La prospective remet en cause les idées reçues. Pour voir loin, large et profond, il faut faire montre de liberté de penser et éviter l’autocensure, le prescrit officiel et le conformisme.”
- Penser à l’Homme : “Fruit de la liberté humaine et non de la fatalité, l’avenir est ouvert et malléable. Il ne s’agit pas de nier l’existence de déterminismes mais bien de comprendre ces derniers en vue d’accroître la liberté de choix.”
Les premiers groupEs de travail français
Dès les années 1960, la France voit émerger divers cercles de réflexion et de recherche en prospective. Parmi eux, on compte notamment le groupe formé autour de Bertrand de Jouvenel, fondateur de la revue Futuribles en 1960.
Cette revue devient rapidement un espace de publication et de discussion majeur pour toutes les questions de prospective. Elle offre un cadre où philosophes, économistes, sociologues et ingénieurs internationaux peuvent confronter leurs idées et leurs visions du futur.
Créé en 1962 à l’initiative de Pierre Massé, Commissaire au Plan3, le Groupe de Travail « Prospective 1985 » fut l’un des premiers laboratoires d’idées prospectives de l’administration publique. Son objectif était d’anticiper les évolutions majeures de la France à l’horizon 1985 en identifiant des scénarios plausibles et en éclairant les orientations du Ve Plan4.
Présidé par Pierre Guillaumat, ancien Ministre des Armées, le groupe réunissait des experts issus de divers domaines (entre autres l’anthropologue Claude Levi-Strauss, Bertrand de Jouvenel, ou encore la professeure d’économie Jane Krier)5. Cette approche interdisciplinaire mêlait économie, sciences sociales et prospective.
Son premier rapport, « Réflexions pour 1985 » (1964), explorait les évolutions démographiques, économiques et technologiques à venir. Ces travaux influencèrent durablement la planification stratégique en France : ils connurent trois rééditions, furent traduit en japonais et diffusés à près de 100 000 exemples. D’autres cellules de prospective furent créées aux ministères des Affaires étrangères, de La Défense nationale et de l’Industrie.6
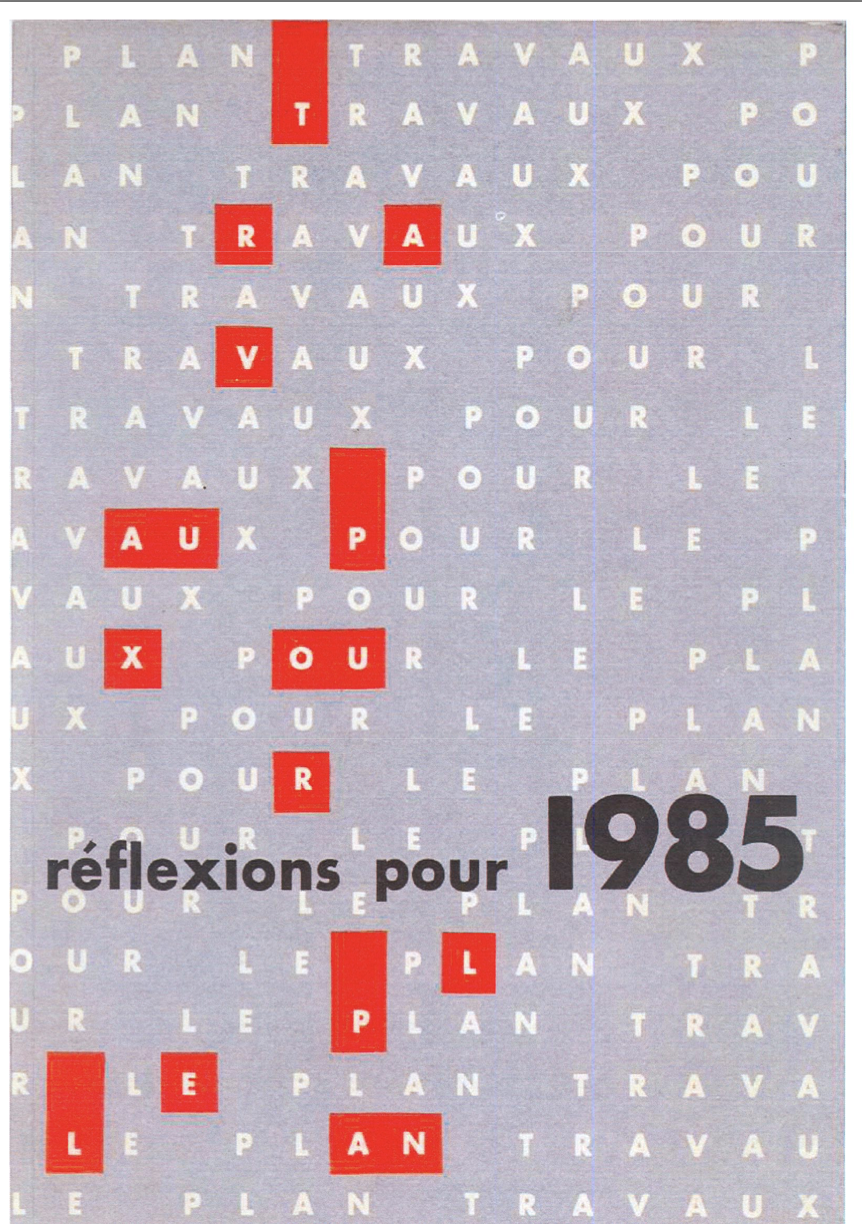
Une prospective créative
“Dessiner l’avenir ne peut être qu’une invitation à cultiver l’imagination.”
Riel Miller
Pour cultiver l’imagination, des outils vont être inventés et conceptualisés. En 1985, Michel Godet, économiste et prospectiviste, publie deux tomes du « Manuel de prospective stratégique »7, dans lesquels il développe ses travaux sur la « méthode des scénarios », les analyses de rupture et les “boîtes à outils” de la prospective stratégique. Elle consiste à décrire de façon cohérente le cheminement entre une situation d’origine et des situations futures possibles8. Elle permet ainsi :
- d’identifier les variables clés du système étudié
- de déterminer les acteurs fondamentaux et leurs stratégies
- de décrire l’évolution du système sous forme de scénarios (c’est-à-dire de grandes hypothèses structurées sur l’avenir)
Pour lui, il s’agit avant tout « d’adopter des méthodes simples et rigoureuses, pour résoudre des problèmes très complexes. »9 Sa méthode des scénarios est largement utilisée dans divers secteurs (industrie, agriculture, démographie) et à différentes échelles géographiques10.
L’héritage de Gaston Berger et des fondements de la prospective à la française repose sur une vision humaniste, ouverte et participative de l’avenir.
Aujourd’hui, que l’on parle de prospective territoriale, d’innovation technologique ou de transitions écologiques, l’élaboration de scénarios demeure un levier essentiel pour imaginer des futurs alternatifs et pour aider les décideurs à évaluer les risques et les opportunités à long terme.
Ce cadre philosophique a permis à la prospective de s’affirmer comme une approche collective et dynamique, ce qui trouve un écho tout particulier dans les pratiques des scénaristes ; et c’est ce que nous verrons dans le prochain article de cette série.