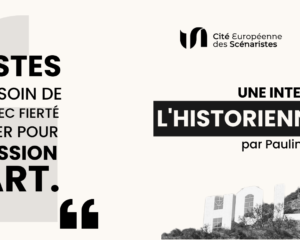Le 18 juin, 41 associations de l’audiovisuel ont signé une tribune contre la privatisation des télévisions et radios publiques. La Cité européenne des scénaristes soutient cette tribune.
Le 10 juin dernier, Sébastien Chenu, porte-parole du RN (Rassemblement national), réitérait au micro de BFMTV, la volonté du parti de privatiser l’audiovisuel public, objectif déjà annoncé lors des présidentielles 2022.
Le 18 juin, 41 organisations, parmi lesquelles l’USPA (Union syndicale de la Production Audiovisuelle), la CGT Radio France et l’ARP (Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs) ont signé une tribune contre la privatisation de l’audiovisuel public.
« Aucun pays européen ne s’est risqué à privatiser l’audiovisuel public », rappellent les signataires, soulignant qu’une telle mesure : « laisserait un marché de l’information et de la création soumis aux seuls intérêts privés au détriment de la recherche de la vérité, du contradictoire et de la diversité des récits, en l’absence du contrepoids d’un pôle audiovisuel public fort et indépendant ».
Présentée par les élus RN comme une mesure permettant d’économiser jusqu’à trois milliards d’euros, la politique de privatisation des chaînes et radios publiques conduirait pourtant à la suppression de « centaines de milliers d’emplois » et menacerait directement l’ensemble de la filière culturelle.
LE PLURALISME ET LA GRATUITE DE L’INFORMATION EN PERIL
Le 30 septembre 1986 est promulgée la loi relative à la liberté de communication, dite Loi Léotard. Elle fait suite à la libéralisation progressive de l’audiovisuel, marquée par la dissolution de l’ORTF en 1975, puis l’autorisation des radios et télévisions locales respectivement en 1981 et 1982 et la création de Canal +, première chaîne privée française, en 1984.
On retrouve dans le texte de loi, qui, encore aujourd’hui, encadre les télécommunications en France, un rappel des principales caractéristiques de l’audiovisuel public :
Les sociétés poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Article 43, Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Un apport essentiel de l’audiovisuel public que les signataires soulignent, rappelant également qu’il est indissociable d’une information égalitaire et disponible partout :
« Radio France et France Télévisions assurent un rôle essentiel en proposant aussi surtout une information et des programmes de proximité, dans toutes les régions, sur tout le territoire métropolitain et ultramarin ».
Retrouvez la pétition ici