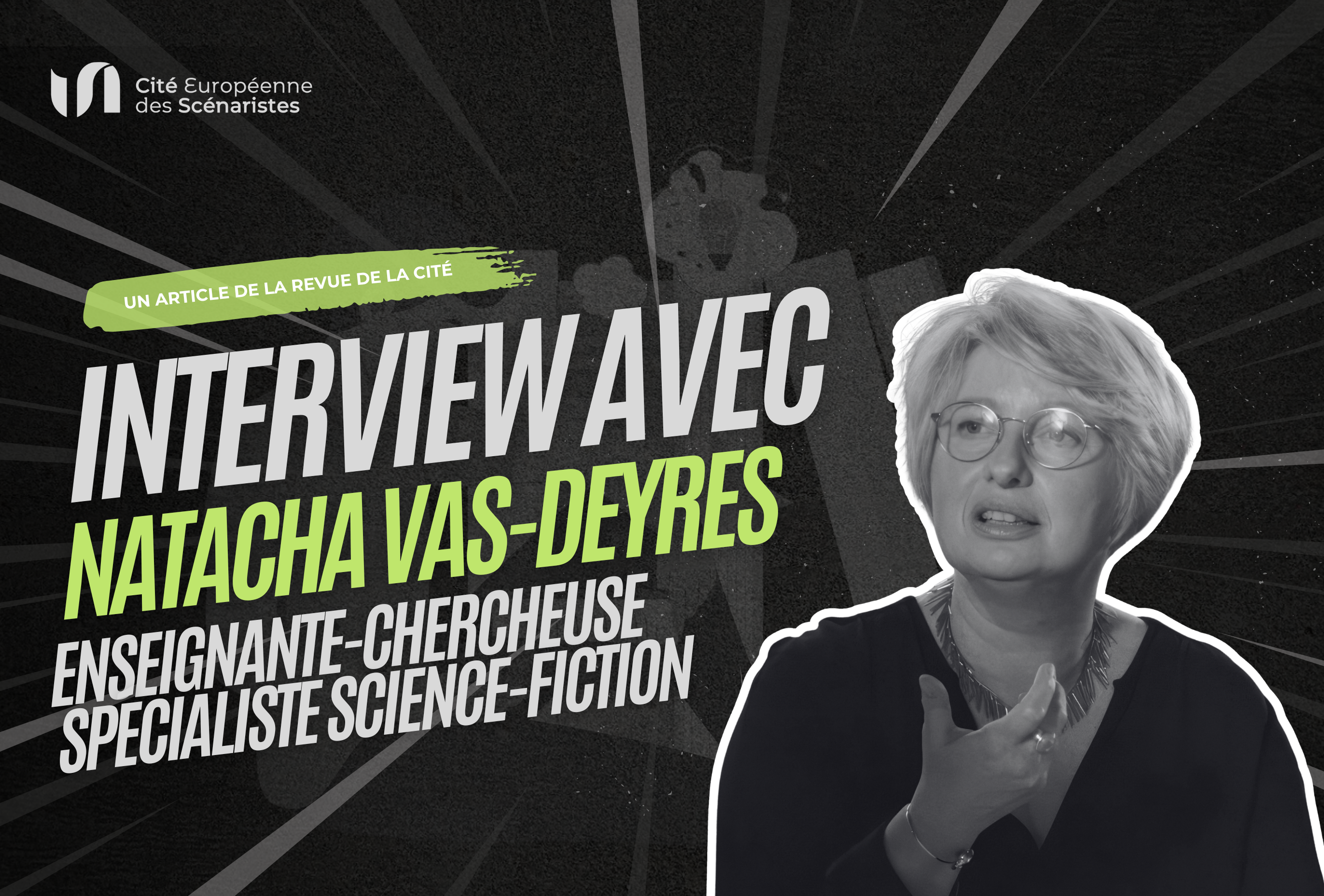Natacha Vas-Deyres est agrégée de lettres modernes, docteure en littérature française, professeure de chaire supérieure en classes préparatoires aux grandes écoles et chercheuse associée de l’université Bordeaux Montaigne.
Elle est spécialiste de l’utopie/dystopie, de science-fiction et d’anticipation française et américaine au XXe siècle (littérature et cinéma). Elle a obtenu deux fois le Grand prix de l’Imaginaire, en 2013 dans la catégorie essai et le Prix spécial, en 2016. La même année, elle obtient le Jamie Bishop Mémorial Award aux Etats-Unis.
Elle est co-fondatrice et présidente du festival Hypermondes depuis 2021.
(photo : © Game TV Ubisoft)
La science-fiction est souvent présentée comme un simple divertissement, mais on la décrit aussi comme un laboratoire d’idées.
En quoi ce genre bouscule-t-il notre manière de représenter le monde — et comment cette richesse est-elle aujourd’hui perçue dans les sphères culturelles ou académiques ?
Outre sa fonction épistémologique, celle d’être un laboratoire d’idées visionnaires mais non prophétiques, la science-fiction est, selon moi, une « mythologisation » de l’avenir.
C’est le seul domaine culturel capable de mettre en récit – littéraire, cinématographique, sériel, ludique – des problématiques émergentes dans notre présent.
Depuis une vingtaine d’années, avec l’introduction des « Cultural studies1 » sur le modèle universitaire anglo-saxon, la production culturelle liée à l’imaginaire (science-fiction, fantastique, fantasy…) développée sur différents médias tels que la littérature, le cinéma, les séries, le jeu vidéo ou les fanfictions, constitue enfin un véritable champ de recherche.
Nous sommes désormais trois générations de chercheuses et chercheurs à explorer la science-fiction sous toutes ses formes : soit d’un point de vue historique, pour valoriser des pans entiers de la littérature de genre ; soit d’un point de vue théorique, pour étudier le fonctionnement spécifique de ces récits, notamment à travers le concept de « paradigme absent » (le lecteur ou le spectateur accepte de rentrer dans une histoire en comprenant partiellement le monde qu’il a sous les yeux), ou encore celui de worldbuilding (la possibilité littérale de créer l’entièreté d’un monde ou d’un univers : sa langue, ses structures sociales, politiques, ses espèces…).
Si les recherches universitaires sur la science-fiction sont encore relativement récentes, l’histoire littéraire, elle, semble beaucoup plus ancienne. Comment s’est-elle construite en France — et pourquoi reste-t-elle si peu connue ?
En tant qu’historienne de la science-fiction, il faut insister sur le fait que les auteurs français écrivent de la science-fiction et de l’anticipation depuis le XVIIe siècle, ne serait-ce qu’en citant Histoire comique des États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac (1657), contenant le premier voyage sur la lune de la littérature française !
À partir des romans de Jules Verne, considéré avec l’anglais H.G. Wells comme le père de la science-fiction, va se constituer un véritable continent littéraire : le merveilleux scientifique, comme un premier état de la science-fiction française, théorisé par Maurice Renard, et produisant des centaines de récits, dont ceux de Rosny aîné.
Si la Première guerre mondiale donne un coup d’arrêt à cette production abondante, par la disparition des revues qui l’éditaient, la science-fiction française renaîtra de ses cendres en 1950, avec le développement de collections chez Hachette et Gallimard, médiatisées notamment par Boris Vian. C’est l’intelligentsia française qui va invisibiliser la science-fiction en la transformant en « subculture »2, pour reprendre les mots de l’éditeur et écrivain Gérard Klein. Mais les écrivains ont toujours été là !
Et dans cette histoire longue, est-ce qu’on peut dégager une « couleur » propre à la SF française ? Un ADN spécifique, qui la distingue des récits anglo-saxons ?
Il me semble difficile de déterminer en quelques mots les spécificités de la SF française. Néanmoins je donnerais deux termes clés que l’on retrouve quasiment à toutes les époques : pessimisme et politique.
Des visions de l’anticipation pessimiste de Jules Verne aux catastrophes du merveilleux scientifique, des dystopies des années 1930, 1970 ou 1990 aux perspectives mortifères sur notre espèce (chez Flammarion, Rosny aîné, Boulle, Merle), notre civilisation ou notre environnement, ce courant prédomine largement — à rebours de la SF américaine dite de l’Âge d’or, souvent plus optimiste et liée à un progrès technologique et scientifique en continu.
Les auteurs et autrices français·es, au-delà du pessimisme, adoptent une position politique claire, parfois radicale — écologiste ou non — se situant à l’extrême-gauche, comme ce fut le cas dans les années 1970 avec Jean-Pierre Andrevon ou Joël Houssin.
Cette position a infusé chez les auteurs et autrices contemporains, notamment sur les questions féministes (ou de genre), avec Joëlle Wintrebert, Élisabeth Vonarburg, Sabrina Calvo, Catherine Dufour, et plus récemment Ketty Steward.
Un auteur comme Ayerdhal, disparu en 2015, symbolise aujourd’hui la figure de l’écrivain engagé projetant dans ses romans des visions utopiques.
D’ailleurs, je suis toujours très étonnée de constater que les scénaristes français ne puisent pas davantage dans le fonds de notre littérature nationale, alors que les Américains ne s’en privent pas — sans même parfois citer l’auteur français !
Saviez-vous que deux personnages de La Machine du pouvoir de Michel Jeury, parue en 1960 au Rayon fantastique, sont deux droïdes — l’un ressemblant à un cylindre à roulettes, et l’autre, en métal doré, un droïde polyglotte ?
Que le concept à l’œuvre dans Inception de Christopher Nolan — l’abolition du temps ou le voyage temporel via la conscience et le rêve — fut inventé, toujours par Michel Jeury, dans Le Temps incertain en 1973 ?
Je rêverais de voir adapté au cinéma, en série ou en animation, le post-apocalyptique français, qui regorge de récits originaux : ceux de Régis Messac, de Jacques Spitz (La Guerre des mouches), de René Barjavel (personne n’a jamais adapté Ravage, Le Diable l’emporte ou La Nuit des temps), ou encore de Julia Verlanger (dont tous les romans, comme L’Autoroute sauvage, ont été réédités chez Bragelonne).
aujourd’hui, selon vous, quels auteurs ou autrices poursuivent cette veine engagée, en croisant politique, écologie et social ?
Toute l’œuvre de Pierre Bordage — et plus spécifiquement Les Dames Blanches, La Trilogie des Prophéties, Chroniques des ombres ou encore Wang —, ainsi que celle de Jean-Marc Ligny avec ses écofictions, offrent des anticipations très justes de notre présent, tant sur le plan social, et politique qu’environnemental.
Les autrices françaises ou francophones — Élisabeth Vonarburg, Joëlle Wintrebert, Christine Renard, parfois proches d’Ursula Le Guin — proposent des modèles sociaux différents, utopiques ou dystopiques, créatifs, inventifs, qui renouvellent en profondeur la fonction des genres et des sexes.
La science-fiction s’hybride parfois au fantastique ou à l’horreur, comme chez Catherine Dufour. Ce ne sont que quelques exemples, mais beaucoup d’œuvres mériteraient d’être (re)connues et adaptées.
On sent, dans ce panorama de la SF francophone, une richesse foisonnante — d’idées, de voix, de visions. Mais une constante semble dominer beaucoup de récits, en France comme ailleurs : le futur est rarement radieux.
Pourquoi ce tropisme dystopique est-il si présent dans nos imaginaires ? Est-ce un biais culturel, une facilité dramatique ou un miroir de nos angoisses collectives ?
Pour comprendre le rapport entre dystopie et science-fiction, il faut remonter aux origines de ce que nous pourrions appeler le genre littéraire de l’utopie.
Quand l’humaniste anglais Thomas More inventa l’utopie littéraire au début du XVIe siècle, il ne pouvait pas se douter qu’il venait de créer un type de récit qui aurait une postérité sans précédent.
Dès le XIXe, la littérature pressent l’apparition de germes totalitaires au sein de modèles sociaux présentés comme parfaits. La dystopie naît de ces visions critiques : quand l’idéologie communiste réalise l’utopie, le récit dystopique met en lumière les rouages d’un État omnipotent, organisé scientifiquement pour formater et oppresser les individus.
Eugène Zamiatine avec Nous autres (1922), Aldous Huxley avec Le Meilleur des mondes (1932), George Orwell avec 1984 (1948) élaborent la matrice de ce type de récit.
La science-fiction, qui se développe dès les années 1920, va offrir à la dystopie un potentiel créatif sans précédent, en la déplaçant dans un ailleurs temporel, sous-tendu par des technologies futuristes ou le voyage dans l’espace.
Les auteurs anglo-saxons produisent dès les années 1940 et 1950 des chefs-d’œuvre dystopiques qu’un succès non démenti par de multiples rééditions transforme en véritables classiques de la littérature mondiale, quasiment tous adaptés au cinéma.
L’État absurde et inculte est illustré par Fahrenheit 451 (la température à laquelle le papier brûle) en 1953, les cités surpeuplées et l’eugénisme sont évoqués par Harry Harrison dans Soleil vert (1973) ou dans Les Monades urbaines de Robert Silverberg (1971).
Dès les années 1920, le cinéma prend le relais de la littérature et met en scène la dystopie en utilisant les moyens spectaculaires de la science-fiction et ses décors futuristes.
Tous les grands thèmes sociétaux y sont exploités : Metropolis de Fritz Lang (1927) ou La Vie future de Cameron Menzies (1936) critiquent les fractures sociales structurelles ; le contrôle social et la manipulation mentale sont dévoilés dans THX 1138 de George Lucas (1971), Fahrenheit 451 de François Truffaut (1966), Brazil de Terry Gilliam (1985), ou encore dans la trilogie Matrix des Wachowski (1999). La maîtrise de la sexualité et les manipulations génétiques sont traitées notamment dans Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol (1997) ou Les Fils de l’homme d’Alfonso Cuarón (2006).
La dystopie propose aux scénaristes un avantage de taille, servant l’histoire : c’est la révolte d’un héros opprimé par un système totalitaire, qu’il ne supporte plus.
C’est le sens même du préfixe dys- : le protagoniste de l’intrigue, en apparence soumis aux contraintes de la société dans laquelle il vit, prend peu à peu conscience de la barbarie de celle-ci. Sa révolte, parfois tragique, est le grain de sable qui va gripper la machine totalitaire et permettre sa chute… ou pas, comme c’est le cas dans la série Black Mirror, aux dénouements parfois ambivalents ou amers.
Même si le cinéma, notamment américain, aime les happy ends, la tentation tragique reste toujours grande. Mettre en scène le bonheur ou l’utopie, plus « statique » et descriptive selon Herbert George Wells, apparaît comme moins performant pour le drame, au sens de l’action scénaristique.
La science-fiction permet-elle de tester des alternatives aux systèmes dominants ? Peut-elle nourrir la réflexion politique en lien avec les enjeux climatiques ?
Si les scénaristes et les scientifiques sont souvent de grands lecteurs ou lectrices, spectateurs ou spectatrices de science-fiction, ce n’est pas le cas des hommes et des femmes politiques, qui goûtent peu l’aspect critique du genre. Mais la créativité politique est aujourd’hui en panne.
S’il nous faut sortir du système capitaliste et de l’économie de marché pour sauver la planète — bien mal en point depuis qu’elle est entrée dans l’Anthropocène3 —, il faut inventer d’autres systèmes de gouvernance et de société.
Nous pourrions revenir à des économies locales, régionales, à une production énergétique différente, à une consommation orientée vers la sobriété — ce que préconise, par exemple, l’écrivain Alain Damasio dans ses interventions publiques.
Ces perspectives existent déjà, mais la science-fiction permet de tester différents curseurs via ses scenarii.
Que faire si l’électricité disparaît subitement ? (réponse dans Ravage de René Barjavel)
Comment vivre dans un monde où l’évolution de la faune et de la flore est rendue inéluctable par le changement climatique ?
La réponse est donnée par Jean-Marc Ligny, qui a travaillé en collaboration avec des membres du GIEC dans Exodes (2012) ou Semences (2015).
C’est par la connexion entre projets politiques, sciences et invention artistique — la transversalité du dialogue — que nous pouvons ré-imaginer collectivement des futurs possibles, et peut-être la survie de l’humanité à moyen terme.
Selon vous, l’impact réel des fictions sur le monde est-il mesurable ? Peuvent-elles vraiment changer la société ?
C’est une interrogation complexe, car elle met en jeu la notion de représentation élaborée à la fois par un imaginaire individuel (l’auteur/autrice, le/la scénariste, le/la réalisateur ou réalisatrice…) et par une nébuleuse d’imaginaire collectif.
Si les fictions mettant en scène le dérèglement climatique — comme les films catastrophes de Roland Emmerich — avaient eu un réel impact, les préoccupations écologistes ne reculeraient pas.
Depuis les années 1970, des romans évoquant l’épuisement de notre civilisation industrielle, comme La Fin du rêve de Philip Wylie, Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrevon, ou encore le récent Le Déluge de Stephen Markley (2022), n’arrivent pas à provoquer de réactions salutaires, malgré la justesse de leurs visions.
L’influence d’une représentation sur un imaginaire est un processus long et opaque.
Depuis les années 1960, la représentation de l’IA dans la science-fiction cinématographique — omnisciente et mortifère (pensons à HAL 9000 de Stanley Kubrick) — a largement influencé médias et grand public, sans correspondre à la réalité scientifique.
Il est certain que les auteurs ont désormais pris conscience que certaines de leurs œuvres apocalyptiques « habituaient » le grand public à une fin inéluctable de notre civilisation (Pierre Bordage utilise le terme d’« habituation » du lecteur), et n’œuvraient pas au renouvellement des imaginaires sociétaux.
Ils tentent aujourd’hui de proposer des futurs plus désirables, comme l’autrice Becky Chambers, qui appartient au mouvement du Hopepunk4, ou l’Italien Francesco Verso, qui s’inscrit dans le Solarpunk5 — un genre en voie de développement, né au Brésil, qui écrit un futur plus sobre.
En parlant de nouvelles propositions, quelles pistes narratives sont encore trop peu explorées en science-fiction ?
Bien que certains récits cinématographiques évoquent des catastrophes climatiques, la tentation reste encore grande de ne pas suffisamment explorer la survie de la civilisation humaine — à moins que ce ne soit en mode barbare, type Mad Max ou La Route.
Il serait intéressant de raconter comment l’humain survit et tente de se reconstruire.
La science-fiction envisage tout à fait la disparition de l’humanité, tout en mettant en exergue le développement d’autres espèces — que ce soit des animaux (Demain les chiens de Clifford D. Simak, immense classique, jamais adapté au cinéma ou en série), des insectes, voire des minéraux (La Mort de la Terre de Rosny aîné), ou encore des végétaux (le génial Le Monde vert de Brian Aldiss).
Dans une veine plus géopolitique, raconter la constitution d’un gouvernement mondial, l’élaboration de ce qui serait une véritable utopie, pourrait être passionnant et salutaire.
Bien que d’assez nombreuses utopies féminines ou féministes aient été écrites par des femmes, très peu sont adaptées au cinéma ou en série — sauf sur le mode parodique…
Est-ce à dire que les hommes ne souhaitent pas voir représenté un monde où ils n’auraient plus la première place ? Je pense à Herland de Charlotte Perkins, La Cité des mères d’Élisabeth Vonarburg, ou encore Les Hommes protégés de Robert Merle ?
La révolte organisée des femmes pourrait être une vision plausible, tout comme l’émancipation des pays de l’hémisphère Sud face à ceux du Nord.
Enfin, le black-out électrique — évoqué dans Black out de Marc Elsberg ou La Grande panne d’Hadrien Klent —, ou encore l’IA perçue comme un nouveau messie, pourraient être des sujets à développer, en littérature ou au cinéma.
Avez-vous des exemples de romans ou de films « prémonitoires » qui ont préfiguré une évolution sociétale, économique, environnementale ?
J’ai été frappée par la lecture de Wang (1996) et L’Ange de l’abîme (2004) de Pierre Bordage, pour leur vision d’une Europe en décadence, avec une natalité en chute libre, se protégeant des vagues de migration venant du Sud et de l’Asie — le héros étant l’un de ces migrants tentant de franchir le gigantesque mur de protection de l’espace Schengen.
Dans F.A.U.S.T. de Serge Lehman, ce sont les États qui cèdent progressivement leurs pouvoirs à d’immenses consortiums privés. C’était en 1995, et le roman préfigurait le pouvoir des GAFAM.
Enfin, Le Déluge de Stephen Markley (écrivain, journaliste et scénariste américain), propose une analyse minutieuse de notre chute, due au manque d’anticipation et d’acceptation du changement climatique.
La chute politique des États-Unis — sujet ô combien actuel ! — racontée dans Le Journal de nuit de Jack Womack fut également une lecture marquante.
On a vu comment certains récits ont su capter l’esprit d’une époque avant même qu’elle n’éclate. Mais aujourd’hui, ce n’est plus seulement le contenu des récits qui évolue : ce sont aussi les outils qui les fabriquent. L’essor des IA génératives et des récits interactifs modifie-t-il le rôle de l’auteur ou du scénariste ? Peut-on s’attendre à un changement radical de nos modes de narration, dans la manière de concevoir et de partager les histoires ?
Travaillant avec des neuroscientifiques, des chercheurs en informatique et en IA, ainsi qu’avec des auteurs, je suis à la fois fascinée (un peu comme tout le monde) par les fonctions exponentielles de l’intelligence artificielle — mais je n’oublie jamais que, d’une part, c’est un outil, et que, d’autre part, rien ne doit jamais remplacer l’intelligence et la créativité humaines.
Les IA ne sont que des programmes élaborés par l’humain : des supercalculateurs et des bases de données uniquement capables de générer des produits culturels normés, biaisés et stéréotypés.
Pour moi, une IA ne produira que des scénarios médiocres, sans la singularité ni le talent issu de l’unicité d’un cerveau humain.
Produire beaucoup, gagner du temps (je me demande toujours pourquoi nous cherchons à toujours gagner du temps sur tout, désormais) grâce à l’IA n’aboutira jamais à un chef-d’œuvre, mais à une compilation de données faite pour plaire à la masse — qui les oubliera aussitôt.
Déjà, le personnage de Julia dans 1984 de George Orwell travaillait au département des romans pour les prolétaires, élaborés à l’aide de scénarios préconçus. L’enjeu ne serait plus artistique, mais politique — manipuler les masses — et commercial.
Je ne suis pas certaine que nos créateurs, auteurs, scénaristes, réalisateurs aient envie de ne plus être des artistes au sens plein du terme.
Enfin, le récit interactif a déjà été « testé » dans la série Black Mirror : c’est une piste intéressante, car le spectateur est en immersion dans une histoire qu’il croit contrôler, et qui le renvoie à la question philosophique du déterminisme de nos existences.
Cela reste une possibilité du récit, mais les lecteurs/spectateurs, je le crois, resteront toujours fascinés par la création de livres-univers mythiques comme Dune ou Star Wars…
Un immense merci à Natacha Vas-Deyres pour cette discussion passionnante !
Interviews d’experts et d’expertes de la prospective
Cet article est le premier de cette série. Retrouvez tous les épisodes ici.