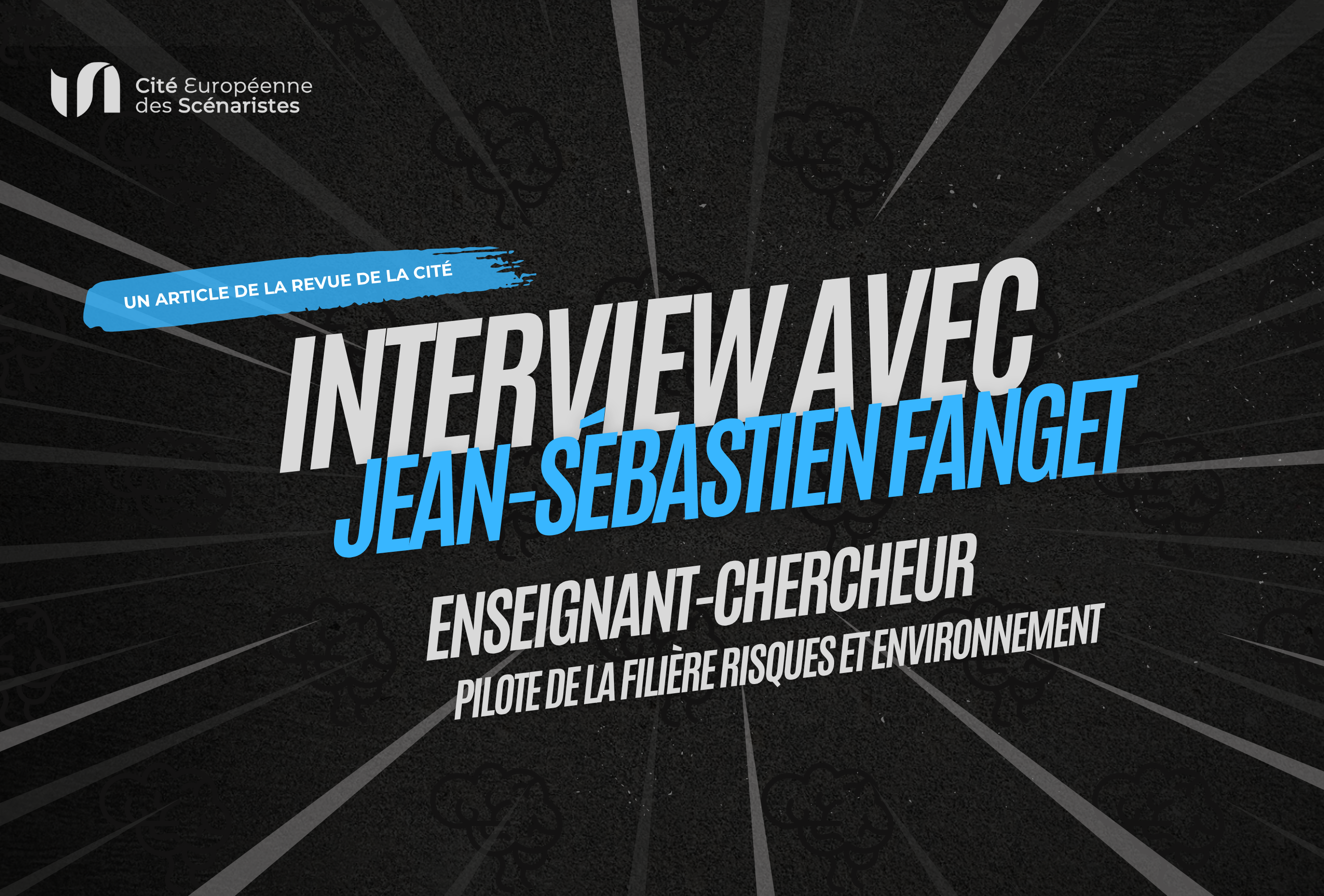Jean-Sébastien Fanget est enseignant-chercheur à l’Esaip, Ecole d’ingénieurs, pilote de la filière Risques et Environnement. Il est également consultant et formateur en Stratégie Sociétale et Performance Globale au sein du collectif Udétopia et anime divers ateliers liés à la transition écologique, tels que la Fresque du Climat et la Fresque de la Biodiversité. Découvrez notre interview !
Pourquoi les concepts de “prendre soin” et vivre-ensemble sont-ils devenus des enjeux majeurs dans les réflexions sur l’avenir ?
Ces enjeux sont fondamentaux pour au moins deux raisons principales.
Tout d’abord, il y a un lien étroit, fort et direct entre le « prendre soin » à l’échelle individuelle (écologie de soi), son extension vers l’écologie des autres (écosystèmes humains et non-humains), et enfin un changement global de notre relation au vivant et au système Terre.
Ensuite, les défis liés aux dérèglements climatiques, qui menacent notre humanité et l’habitabilité de la planète, ne peuvent être résolus ni par un individu seul, ni par une approche purement technologique, ni par aucune forme d’Intelligence Artificielle1.
La seule approche qui semble viable scientifiquement est l’intelligence collective et la gouvernance partagée. Ce sont elles qui nous obligent à réinterroger et réinventer notre relation au « prendre soin », au « vivre ensemble », ainsi que notre manière d’habiter la Terre et de gérer nos écosystèmes et leurs métabolismes.
Un chiffre clé : contrairement aux idées reçues, seuls 15% des dérèglements climatiques sont directement liés aux émissions carbone et aux gaz à effet de serre. En réalité, 80% de ces dérèglements proviennent de notre façon d’habiter la Terre, de notre gestion des sols et de notre manière de produire notre alimentation.
C’est pour cette raison que je développe principalement les concepts de « Société Syntropique » et « Civilisation Syntropique » : une civilisation syntropique2 serait une cohabitation symbiotique entre humains, techniques et écosystèmes (humains comme non-humains), dans le respect des limites biophysiques du système Terre.
Comment intégrez-vous ces concepts dans votre travail de prospective ?
Dans mon approche, j’essaie justement de dépasser le cadre dominant dans lequel évoluent ces questions. Aujourd’hui, nous vivons dans une société de la performance — en particulier dans le monde occidental — dont les logiques s’étendent à l’échelle globale. Même des notions comme le “prendre soin” ou le “vivre ensemble” se retrouvent évaluées à travers ce prisme : performance sociale, économique, environnementale… jusque dans les formes de gouvernance.
Face à cela, mon travail de prospective consiste à élargir les perspectives. J’intègre notamment les notions de robustesse — cette capacité à encaisser les chocs sans perdre ses fonctions essentielles — et je m’intéresse à des modèles économiques et sociétaux alternatifs, souvent inspirés du vivant.
Je pense par exemple à l’économie symbiotique3 et l’économie régénératrice4, qui s’inspirent des principes du vivant pour promouvoir des interactions économiques durables. Ces approches sont notamment soutenues par Isabelle Delannoy5 et trouvent des échos dans les travaux6 d’Olivier Hamant, qui explorent la robustesse du vivant et critiquent le culte de la performance humaine.
Il y a aussi l’économie du Donut7, développée par Kate Raworth8, qui vise à concilier prospérité sociale et respect des limites planétaires
On pense également à la perma-économie9, inspirée de la permaculture, qui conçoit des modèles économiques résilients, durables et ancrés dans la coopération entre acteurs économiques. Maurizio Pallante, défenseur de la décroissance et de l’autonomie locale, apporte des réflexions complémentaires à ce modèle.
On peut aussi citer les modèles biomimétiques, qui s’inspirent du vivant pour repenser l’économie et les organisations. Stefano Mancuso, spécialiste en neurobiologie végétale, met en lumière les stratégies d’adaptation et de coopération des plantes comme sources d’inspiration pour des systèmes économiques circulaires.
Ces approches ne sont pas seulement des alternatives abstraites : elles répondent directement aux défis majeurs que nos sociétés doivent affronter. Face aux crises climatiques, aux tensions sociales et aux limites des modèles actuels, elles offrent des pistes concrètes pour imaginer un avenir plus soutenable.
Qu’est-ce qui freine aujourd’hui une société du ‘prendre soin’ et du vivre ensemble ?
Il existe aujourd’hui différents types de freins. D’abord, des freins dits “classiques”, omniprésents, qui empêchent une compréhension claire des enjeux. Parmi eux, l’abus de langage joue un rôle majeur : on parle souvent de « changement climatique », alors qu’il serait plus juste d’évoquer des « dérèglements du système climatique et du système Terre ». Ce glissement sémantique masque une réalité bien plus vaste et systémique.
La complexité même des sujets crée aussi de la confusion. Beaucoup de personnes ne font pas la distinction entre « réchauffement climatique » et « dérèglements du système Terre », alors que ces concepts recouvrent des phénomènes distincts, avec des implications différentes.
S’ajoute à cela une hyperfocalisation sur la performance et une tendance au « techno-solutionnisme »10. Le discours dominant met aujourd’hui l’accent sur la décarbonation, alors que l’enjeu fondamental réside ailleurs : dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, en particulier les forêts.
Un autre frein majeur tient à l’hystérisation11 du temps et à une vision court-termiste. Nous vivons dans une tension permanente entre la nécessité de penser en termes de générations futures et l’accélération imposée par la financiarisation outrancière, qui exige des résultats immédiats, sans vision d’ensemble.
Des freins culturels, organisationnels et cognitifs s’ajoutent encore à cette complexité. On observe des biais d’optimisme – qui mènent à la minimisation des risques –, des biais de confirmation, des chambres d’écho où l’on reste enfermé dans des cercles de pensée homogènes, une dilution des responsabilités, et un sentiment d’impuissance qui nourrit le statu quo. Ces “déficits cindyniques”, autrement dit notre mauvaise appréhension du danger, bloquent les changements nécessaires.
Enfin, il ne faut pas confondre éducation, sensibilisation et instruction. Informer sur “le changement climatique” ne suffit pas à transformer les comportements. Il faut aller plus loin, engager un véritable travail de transformation des représentations, des pratiques et de la manière dont on perçoit notre rapport au vivant.
Mais les freins les plus profonds tiennent à une erreur de langage encore plus fondamentale. Le terme même de “transition” est un abus. Il donne l’illusion d’un passage progressif, maîtrisé. Or, pour des raisons économiques et politiques, nous avons assisté à un véritable dévoiement de la notion d’écologie.
En quoi le mot ‘transition’ pose-t-il problème lorsqu’on parle d’écologie ?
Historiquement, les grandes transformations ne se sont jamais construites sur une « transition » : on ne parle pas de la “Transition française de 1789”, de la “Transition industrielle”, de la “Transition Russe de 1917”, de la “Transition Néolithique”, de la “Transition féministe”, de la “Transition du travail des années 1980”, de la “Transition des Lettres”, etc… mais bien de Révolutions.
Nous avons besoin de nouveaux récits, de nouveaux mythes fédérateurs.
Quelques pistes possibles : la “Révolution Écologique de 2025”, la “Transformation Collective de 2026”, la “Grande Régénération du XXI ème” ou bien la “Révolution Bleue”…
Vous soulignez le besoin de nouveaux récits. Pouvez-vous expliquer Pourquoi il est si crucial de réhabiliter la notion d’écologie ?
Nous avons besoin de réhabiliter la notion d’écologie comme l’histoire de notre relation, à nous, au « Nous », au monde et au vivant.
C’est un enjeu majeur pour la bonne et simple raison que sans cela, nous serons face à des crises brutales, violentes, et a minima à la disparition d’une importante partie de l’humanité, d’ici une centaine d’années.
Les trois grands défis qui y sont associés sont les suivants :
- la réhabilitation d’une relation juste entre l’humain et l’humain, ainsi qu’entre l’humain et le reste du vivant
- le passage d’une économie politique de l’extractivisme et de la morbidité à une économie politique de la régénération et du vivant
- l’invention d’un ou de plusieurs nouveaux récits fédérateurs pour notre avenir proche et plus lointain, qui soient joyeux, optimistes et réalistes.
Quel rôle la prospective peut-elle jouer dans la création de nouveaux récits ?
Pour inventer ces nouveaux récits, il est essentiel de comprendre qu’il n’y a pas de frontière forte entre prospective et fiction sur ces sujets. Il est essentiel qu’il y ait une coopération étroite entre ces deux approches. D’ailleurs, si nous avons tendance à croire que la fiction se base sur une réalité plausible, nous oublions souvent que, par le jeu des conventions sociales, la réalité elle-même est une des fictions possibles…
Le second aspect est l’approche neuro-scientifique de ce phénomène.
Pour la plupart des individus, il est nécessaire d’être exposé à deux, voire trois utopies pour compenser une dystopie ou contre-utopie. Or, notre société est aujourd’hui saturée de dystopies, avec très peu d’utopies réalistes.
Il y a donc deux grands défis à relever : prendre conscience du lien puissant entre prospective et fiction, et de la responsabilité qu’ont les récits et l’écriture narrative dans la manière dont nous envisageons le futur, et puis produire de nouveaux récits et mythes fédérateurs qui ré-ensauvagent12 et ré-enchantent le monde.
En ce sens, la construction de récits narratifs fondés sur les analyses prospectives scientifiques est essentielle. A minima, les écrivains et scénaristes doivent avoir un accès créatif à du contenu sur ce point.
Je suis convaincu que les analyses prospectivistes peuvent profondément nourrir les récits narratifs mais cela est aussi valable dans l’autre sens, les récits narratifs et la créativité fictionnelle peuvent nourrir les hypothèses et l’inspiration prospectiviste.
C’est là que le rôle des scénaristes, écrivaines, écrivains et créatrices et créateurs devient crucial : comment transformer ces alternatives, ces imaginaires du vivant, en récits capables de toucher, de mobiliser, de rivaliser culturellement avec la puissance des dystopies ?
Il y a selon moi deux approches possibles pour répondre à cette question.
- La première est d’aller dans la continuité des initiatives existantes du genre, en narration cinématographique ou littéraire, et en multiplier les déclinaisons (NdA : retrouvez la liste des références ci-dessous, dans l’encart « Pour aller plus loin »).
- La deuxième approche est d’imaginer des fictions où les enjeux écologiques (au sens social comme environnemental) sont la norme, rendant toute autre norme désuète, voire “has been”. La belle verte de Coline Serreau illustre bien cette idée en proposant une société où l’entraide et l’harmonie avec la nature ne sont plus des utopies mais des faits acquis. De la même manière, La cité des Permutants d’Alain Damasio inscrit ces enjeux au cœur d’un monde où ils sont devenus la norme.
L’enjeu est donc de jouer sur la normalité des comportements vertueux, en s’appuyant sur une analyse prospectiviste positive et non sur une narration fondée sur la peur ou le catastrophisme.
Les récits et les fictions ont un impact réel sur le monde, et ils peuvent influencer à la fois les orientations prospectives et les comportements sociaux.
Ce fût le cas du documentaire Demain de Cyril Dion qui a été un propulseur des initiatives en permaculture, des formations et de la création de communautés recherchant l’autonomie alimentaire respectueuse du vivant. Son influence s’est même étendue à des initiatives para-étatiques, comme celles portées par les associations « Regain » et « Terre de Liens ».
D’autres récits ont eu un impact tout aussi concret : Erin Brockovich de Steven Soderbergh a incité les Américains victimes de pollution à porter plainte et se constituer partie civile. The True Cost d’Andrew Morgan a mis en lumière les ravages de la fast fashion, suscitant non seulement des réglementations, mais aussi un changement dans les comportements des consommateurs, qui se tournent davantage vers le vêtement de seconde main et une mode plus éthique.
On peut citer aussi le cas de Silent Spring, livre de Rachel Carson qui est à l’origine de l’interdiction du DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane, un pesticide aux effets dévastateurs sur la faune et la santé humaine) ou encore le merveilleux ouvrage Sapiens de Yuval Noah Harari qui a permis de modifier les pratiques d’enseignement dans les pays scandinaves, en intégrant une approche plus large des enjeux écologiques et sociétaux.
On voit bien que la fiction peut façonner le réel et sur tous les sujets, et “le prendre soin” et le vivre-ensemble n’échappent fort heureusement pas à cette règle.
Pour aller plus loin : les récits, films et ouvrages inspirants
Fiction et prospective écologique :
– Le Siècle bleu et La Révolution bleue – Jean-Pierre Goux
Des romans d’anticipation centrés sur les enjeux écologiques liés à l’eau et aux imaginaires politiques du futur.
– Demain – Cyril Dion
Documentaire qui présente des solutions concrètes aux crises écologiques et sociales, en misant sur le récit positif comme levier d’action.
– The Biggest Little Farm – John Chester & Mark Monroe
Récit documentaire d’un couple transformant une terre stérile en ferme modèle : une fable écologique vécue.
– Aluna – Alan Ereira
Film donnant la parole aux Kogis, peuple indigène de Colombie, porteur d’une vision holistique du vivant et de l’équilibre Terre-Humain.
– La Prophétie des Andes – James Redfield
Roman à succès mêlant spiritualité et écologie, explorant la quête de sens et de reconnexion au monde vivant.
– Symbiotic Earth – John Feldman
Documentaire retraçant le parcours de la biologiste Lynn Margulis et ses théories sur la coopération au cœur de l’évolution.
– Le Sel de la Terre – Wim Wenders
Portrait du photographe Sebastião Salgado et de son œuvre, entre engagement artistique et régénération écologique.
– Ecopolis – Joe Murray
Série documentaire explorant les villes du futur et les solutions technologiques pour un urbanisme durable.
– Sand Talk – Tyson Yunkaporta
Essai puissant sur l’intelligence collective, les savoirs autochtones et les récits comme outil de transformation culturelle et écologique.
Et encore aller plus loin : quelques initiatives inspirantes réelles
Modèles concrets de transformations sociétales :
– Yacouba Sawadogo – « L’homme qui a stoppé le désert » (Burkina Faso) : création d’une forêt sur des terres arides grâce à des techniques agroécologiques locales.
– Sebastião et Lélia Salgado – Projet de reboisement au Brésil mené en parallèle d’un travail photographique engagé.
– Schumacher College (Royaume-Uni) – École alternative fondée sur l’écologie appliquée et la gouvernance symbiotique.
– Architecture bio-inspirée – Notamment le Eastgate Center au Zimbabwe, inspiré par la ventilation naturelle des termitières.
– Monnaie locale Serafu (Kenya) – Indexée sur l’engagement social et écologique, favorisant une économie solidaire dans les bidonvilles.
– Mode de vie des Samis (Scandinavie) – Rythmes et logiques de vie intégrées aux cycles naturels.
– Ville de Detroit (États-Unis) – Résilience urbaine par l’agriculture urbaine et la permaculture après la crise industrielle.
Sources d’inspiration systémiques ou historiques :
– Les civilisations du passé, leur ingénierie écologique et leurs formes de gouvernance coopérative.
– La bio-inspiration (écosystèmes, forêts, sols, biodiversité terrestre, souterraine, océanique).
– Les systèmes de gouvernance partagée et la sociocratie, comme alternatives au modèle hiérarchique dominant.
– Les indicateurs scientifiques à impact, comme la régénération des forêts ou la qualité des sols, pour réorienter les priorités politiques.
Interviews d’experts et d’expertes de la prospective
Cet article est le premier de cette série. Retrouvez tous les épisodes ici.