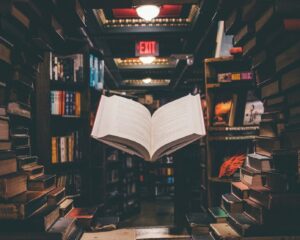« Un film est une proposition. Une critique est une proposition sur une proposition. Ce sont des subjectivités qui se cognent les unes aux autres. »
Philippe Rouyer . .

Chaque semaine, un corps de métier différent de l’audiovisuel témoigne de son rapport au scénario.
Aujourd’hui, la parole est aux critiques de cinéma
Baptiste Rambaud accueille Brigitte Baronnet (AlloCiné) Sophie Grech (Pardon le Cinéma), Philippe Rouyer (Positif, Le Cercle, Mauvais Genre), et Laurent Delmas (France Inter).
Depuis ses débuts, le 7ème art n’a cessé d’être l’objet de débats enflammés, d’analyses et de critiques. Parmi ceux qui façonnent notre regard sur les films, les critiques de cinéma occupent une place centrale. Eux ne travaillent pas directement avec le scénario mais leur métier de journaliste les amène parfois à l’étudier, à le qualifier et à le promouvoir.
Qu’ils soient passionnés, professionnels ou influents sur les réseaux sociaux, ces observateurs aguerris décortiquent les œuvres, en révèlent les forces et les faiblesses, orientent parfois le succès d’un film… ou sa chute.
Comment les critiques de cinéma s’approprient-ils le scénario ? Y ont-ils facilement accès ? Quels sont leurs relations avec les scénaristes ? Comment arrivent-ils à donner envie au spectateur ? Pourquoi y a-t-il parfois un gouffre entre leur critique et celle du public ?
Un objet invisible mais central
Le scénario est un élément difficile à saisir pour les critiques car il est rarement accessible. Même lorsqu’ils découvrent l’œuvre terminée, le scénario écrit n’est jamais visible à proprement parler, on le devine seulement.
« Le scénario on y a rarement accès, on a le film mais le film ce n’est pas le scénario »
Philippe Rouyer
« Ça reste un objet assez mystérieux parce que je n’y ai quasiment jamais accès. »
Brigitte Baronnet
Son importance peut varier selon les critiques et leur sensibilité, mais il est tout de même pour chacun un élément crucial qui nécessite une attention particulière.
« C’est ce sur quoi je vais me focaliser le plus, c’est l’intention scénaristique que je vois en premier dans un film. C’est une histoire très complète et très construite qui va venir me chercher »
Sophie Grech
« J’ai l’impression de distinguer l’objet scénario de l’enjeu scénario. L’objet scénario c’est un fantôme, c’est-à-dire qu’une fois que le film est tourné – et même sur le tournage – ça devient le rêve de quelque chose qui n’adviendra peut-être pas. L’enjeu scénario, c’est qu’il a bien une existence par les dialogues. Cette existence on l’a sous les yeux et dans les oreilles et il faut impérativement en tenir compte dans l’approche critique qu’on peut avoir parce que c’est au cœur des choses. »
Laurent Delmas
Finalement le scénario est vu chez les critiques comme une base permettant ensuite au film d’exister par lui-même.
« Le problème c’est que le scénario est une étape. Il y a des scénarios très littéraires, très réussis mais qui ne feront pas un bon film parce qu’ils ne pensent pas assez en images. Un bon scénario c’est quelque chose qui ressemble à un livre et à une pièce de théâtre mais qui anticipe un film. »
Laurent Delmas
« Le scénario c’est ce socle, qui, s’il est un peu bancal, va être plus compliqué à solidifier par la suite. »
Sophie Grech
La place des scénaristes en France vs dans le cinéma anglo-saxon
En France, le scénario est donc considéré comme une étape participant à la création du film et non pas comme une œuvre à part entière. Il est en quelque sorte un fantôme qui hante l’objet film et son invisibilisation explique en bonne partie le statut précaire des scénaristes. A l’inverse des Etats-Unis, qui accordent une place beaucoup plus importante au scénario et à la profession.
« Le statut du scénario et du scénariste n’est pas du tout le même à Hollywood et en France. En France c’est très difficile d’être scénariste parce que le scénariste va toujours être au service d’un metteur en scène. En France, on est dans la culture du metteur en scène »
Philippe Rouyer
« Il y a un vrai décalage entre les scénaristes en France et aux Etats-Unis, où ce sont les stars. »
Brigitte Baronnet
Et si les scénaristes restent dans l’ombre, c’est surtout à cause d’une chaîne de production inadaptée dont les journalistes et les médias ne sont pas exempts.
« Des rémunérations insuffisantes, une valorisation de l’objet scénario insuffisante, des filières qui restent là aussi insuffisantes. »
Laurent Delmas
« C’est tout un écosystème à revoir, les médias en parlent peu parce qu’ils ne sont pas connus mais c’est parce qu’on n’en parle pas qu’ils ne sont pas connus ! »
Brigitte Baronnet
« Moi je suis frappé par le peu de place que les journalistes et critiques accordent à la parole des scénaristes. »
Laurent Delmas
Une situation à laquelle les critiques de cinéma participent aussi
« Si je fais le bilan des personnes que j’ai interrogées ces trente dernières années, on ne va pas trouver beaucoup de scénaristes, donc c’est un mea culpa. »
Laurent Delmas
Mais à laquelle nos invités aimeraient pourtant remédier
« On sait bien qu’en littérature – le scénario c’est d’abord de la littérature – la rature comme le brouillon c’est formidablement intéressant” nous explique Philippe Rouyer, en donnant pour exemple le passage de la madeleine dans Du côté de chez Swann, “Le 20ème siècle littéraire a fonctionné sur une madeleine, et bien c’est très intéressant de savoir que le premier mot c’était biscotte ! Ce n’est pas anecdotique. Donc cette jachère, cette archéologie, ce tréfond, c’est très intéressant d’aller l’explorer. Mais encore faut-il qu’on y ait accès. »
Philippe Rouyer
« Ça serait formidable pour chaque film d’avoir la présence de quelques propos intéressants sur ces intentions, sur ce qu’il a voulu raconter. »
Laurent Delmas
Donner envie au spectateur/ à la spectatrice, mais comment ?
Lorsqu’ils parlent des films, les critiques ont une responsabilité narrative. Ils ont pour mission de donner envie à leurs lecteurs et doivent donc aller chercher les éléments qui font l’originalité d’un film et les mettre en avant.
« On ne va pas convaincre quelqu’un en disant : « allez voir le film, il est bien ». On attire quelqu’un en disant : « c’est l’histoire de… » »
Laurent Delmas
« Personnellement, je pense que toutes les histoires ont déjà été racontées, donc moi j’essaie toujours de trouver, que j’aime le film ou non, l’élément narratif apporté qui rend ce film unique. »
Sophie Grech
« J’essaie de trouver l’originalité qu’il y a dans le film. »
Brigitte Baronnet
Finalement, la critique est toujours subjective car elle dépend de l’expérience de son auteur, de ses goûts et même du contexte d’écriture.
« La critique est toujours un autoportrait. »
Philippe Rouyer
« Ce n’est pas une histoire qu’on résume, c’est un traitement, c’est un angle, c’est un propos. »
Laurent Delmas
« Un film est une proposition. Une critique est une proposition sur une proposition. Ce sont des subjectivités qui se cognent les unes aux autres. »
Philippe Rouyer
Ainsi certains aspects d’un film peuvent être interprétés de façon différente selon les personnes ou même selon les besoins d’un seul et même critique.
« La plupart du temps, les grandes qualités qu’on va trouver on peut aussi les retourner. Les films que je déteste le plus viscéralement, leurs grands défauts, je peux aussi y voir des forces formidables. »
Sophie Grech
La théorie ou la pratique ?
Il existe de nombreux chemins pour devenir scénariste, et notamment des théories rédigées dans des manuels mais qui peinent à convaincre les professionnels du métier. Qu’en pensent nos critiques ?
« on va nous inculquer des méthodes et c’est bien de les lire, d’en entendre parler une fois mais pour mieux s’en éloigner après. Y’a deux trois trucs de bases à respecter et ensuite oublions tout. Comment fait-on pour à la fois être bonne élève, appliquer les méthodes tout en développant notre personnalité ? »
Brigitte Baronnet
« Les manuels de scénario pour moi, ce sont des bons livres de déblocages potentiel. C’est bien si on a déjà du recul, c’est tout. »
Sophie Grech
L’écart entre la critique et le public
Ces vingt dernières années, l’écart de note entre la critique presse et la critique spectateurs a eu tendance à se creuser. Un phénomène que les critiques de cinéma interviewés imputent largement à la façon dont le scénario est perçu.
« Il y a un truc qui était très marquant sur ces dernières années, c’est le clivage entre la note presse et la note public »
Sophie Grech
« Si on parle du cinéma de pur divertissement, sa durée de vie est inversement proportionnelle, ça ne sera pas un film qui dure. Qu’il y ait un cinéma presque jetable, comme il y a une littérature jetable, il faut l’acter. Que la critique se coupe du public parce qu’elle n’adhère pas au jetable, je ne suis pas très sûr que ce soit nécessairement très vrai. Le rôle de la critique est précisément de dire ce qui est jetable est ce qui n’est pas jetable. Mais soyons clair, il ne s’agit pas d’opposer à ce point-là les uns et les autres et surtout en disant que la critique aurait le bon goût, le goût parfait. Ça je n’y crois pas. »
Philippe Rouyer
Message aux scénaristes
« Regardez des films, lisez des scénarios, ça fera un chemin en vous. C’est en forgeant qu’on devient forgerons et aussi en se passionnant pour le travail des autres »
Philippe Rouyer
« Il n’y a pas de barrière de genre. Donc ne vous limitez pas, faites ce que vous voulez. Il ne faut jamais baisser les bras si on a envie de faire un genre en particulier. Oser des trucs ! »
Sophie Grech
« Ne lâchez rien, croyez-en vous ! »
Brigitte Baronnet
Un choix scénaristique qui les a marqués
The Batman, Matt Reeves, 2022
« J’ai aimé que le dernier Batman commence par Batman en voix off. Ça annoncé la nature “film noir” du film. »
(Laurent Delmas)
Illusions Perdues, Xavier Giannoli, 2021
« La voix off est très présente et moi ça m’a pas du tout déplu, au contraire, je trouvais que ça donnait une saveur différente au film. »
(Brigitte Baronnet)
Selon la Police, Frédéric Videau, 2022 et Antigone, Sophie Deraspe, 2020
« Ils alternent les types de dialogues en ayant tantôt du sur-écrit très littéraire, tantôt du viscéral, presque improvisé avec des changements de ton extrêmement brutaux. Les deux m’ont surpris et ça m’a fascinée. »
(Sophie Grech)
Serre-moi fort, Mathieu Amalric, 2021
« Ça ne correspond pas aux canons habituels et c’est déstabilisant mais c’est très bien ainsi parce qu’au fond, si on va dans une salle de cinéma, ce n’est pas pour être confortablement installé et roupiller. »
(Philippe Rouyer )
Un immense merci à nos invités et à Baptiste Rambaud pour ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes
Liens :
- Spotify
- Apple podcast
- YouTube