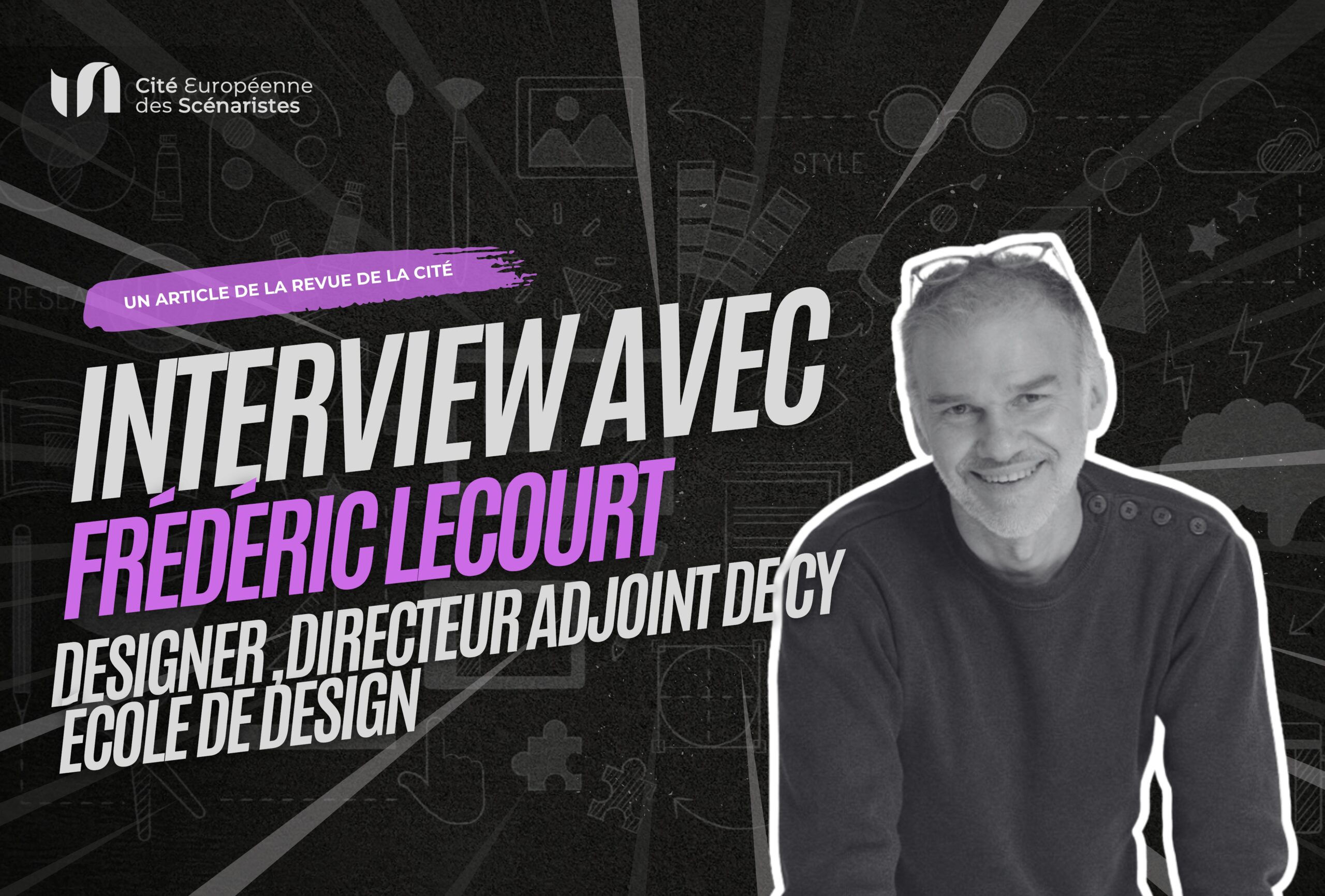Frédéric Lecourt est designer et co-fondateur en 1996, avec Antoine Fenoglio, des Sismo, un studio de design indépendant basé à Paris et à Lavaufranche, en Creuse. Parmi ses réalisations notables figurent les gammes de moulins électriques pour Peugeot et une gamme d’interrupteurs avec et pour le groupe Legrand (2006, Grand Prix design et accessibilité pour tous à la Biennale internationale du design de Saint-Étienne). Depuis 2019, il enseigne le design thinking à Sciences Po et occupe le poste de directeur adjoint de CY École de Design depuis 2023. Voici notre conversation avec lui.
On commence par une question simple… mais peut-être pas tant que ça : c’est quoi le design ?
Le mot « design » est encore très mal compris, surtout dans les pays francophones. En anglais, « design » est un verbe, ça veut dire « concevoir ». En français, on a perdu ce sens. Le mot vient de l’italien « disegno » qui signifie à la fois « dessin » et « dessein/projet ». À la Renaissance, Léonard de Vinci était un designer avant l’heure : il maîtrisait les sciences, l’ingénierie et les arts. Mais aujourd’hui, on dit « une chaise design » et on réduit tout à l’esthétique.
Pour moi, le design est un mode de conception à part entière, comme l’ingénierie. Mais là où l’ingénierie vise une destination bien définie, le design est un voyage. On part, on teste, on déconstruit le cahier des charges, et on avance pas à pas. On ne sait pas exactement où l’on va. C’est un mode de conception qui intègre l’incertitude. Et c’est ça qui est génial.
Cela me fait penser à l’écriture, entre l’architecte qui planifie tout, et le jardinier qui attend de voir ce qui pousse…
Exactement. Dans la BD, c’est comme Giraud/Moebius. Giraud suit un scénario préétabli, avec des gentils, des méchants, une tension. Moebius, lui, est dans l’écriture spontanée. Quand on lit Le Garage Hermétique, on sent qu’il ne connaissait pas la chute en débutant. Le design, c’est plus proche de Moebius. On a voulu le faire entrer dans le monde de l’ingénierie, le rendre maîtrisable. Mais c’est un art de l’incertitude.
Le « design fiction », comme le « design thinking », est presque un pléonasme. C’est comme si les designers ne pensaient pas ou ne faisaient pas d’anticipation. En fait, on est tous des affabulateurs. On dit qu’on sait faire des choses qu’on n’a jamais faites. C’est ainsi qu’on progresse. On veut faire croire qu’on maîtrise, alors qu’on est en plein voyage.
Le design est une fiction en soi.
Comment prépare-t-on alors les étudiants à imaginer et concevoir le design du futur avec cette approche ?
On enseigne beaucoup de sciences humaines et sociales. On les invite à lire, à s’intéresser à cet animal étrange qu’est l’humain, ses rites, ses croyances, ses imaginaires. Il faut aussi s’intéresser à la matière, aux matériaux, aux processus de transformation : tout vient de là. Même cette conversation, qui passe par un signal électrique et se transforme en vibrations sonores, est profondément matérielle.
Et enfin, il faut observer comment on prend des décisions, individuellement et collectivement. Tout cela alimente une posture de curiosité et d’étonnement. Il faut apprendre à suivre ses intuitions. C’est très difficile.
Je dis souvent à mes étudiants d’aller passer trois heures à un carrefour. D’observer pourquoi certaines personnes dépassent le bord du trottoir au feu rouge. Pourquoi regarde-t-on systématiquement si le bus arrive, même si ça ne le fait pas venir plus vite ? Pourquoi commande-t-on du jus de tomate dans l’avion, alors qu’on n’en boit jamais ailleurs ? Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ? Ce sont ces petits moments d’étrangeté qui doivent éveiller l’attention du designer.
C’est un entraînement à voir ce que les autres ne voient pas, à décoder les rituels invisibles… Comment cultiver ce regard décalé ?
Il faut traverser les illusions. L’humain vit dans un monde fictionnel. On partage des fictions collectives – sur l’économie, la politique, la religion. Le rôle du designer, c’est d’essayer d’enlever les lunettes déformantes, ou au moins d’en faire des hypothèses. Et ensuite, de produire des « réponses projets », des choses qu’on jette dans le monde pour tester.
On a souvent cantonné le design à un rôle décoratif. Mais votre approche montre qu’il peut jouer un tout autre rôle. Comment le réinscrire dans les décisions qui comptent ?
Le grand enjeu, c’est de faire entrer le design à la table des décisions. Pas seulement quand il faut faire un bel objet ou un « joli capot », mais bien plus en amont. C’est encore difficile en France, moins dans les pays nordiques ou anglo-saxons. Apple a compris ça. Ce qui fait la différence dans un Iphone, ce n’est pas la technologie – il n’y a rien de propriétaire – c’est le design.
Ils ont supprimé les notices, car si l’objet est bien conçu, il se suffit à lui-même. C’est comme les panneaux ajoutés dans les ascenseurs ou sur les imprimantes pour expliquer ce que les gens ne comprennent pas : un échec de design.
Donc l’objectif, c’est de faire entrer cette vision du design dans les décisions politiques, sociales, environnementales…
Oui, pour moi, le design doit redevenir un outil de transformation sociale. Il peut aider à reformuler les vrais problèmes.
Par exemple : ce n’est pas comment faire des économies de chauffage, mais comment continuer à être heureux en consommant moins d’énergie. Cela change tout. Et si baisser le chauffage crée des tensions dans la famille, c’est raté.
Il faut réinterroger nos modes de vie, nos manières de vivre ensemble. Le design peut relier ce qui a été séparé. Il traverse les strates techniques, économiques, sociales, culturelles. Et c’est pour ça que certaines organisations ont du mal à le comprendre : il vient bousculer les silos.
Vous parlez d’imaginaires collectifs et de récits. En quoi sont-ils indispensables à l’acte de concevoir aujourd’hui ?
On ne peut plus simplement poser un objet sur la table en espérant changer le monde. Il faut remonter aux usages, aux scénarios d’usage. Et pour ça, il faut s’appuyer sur des imaginaires collectifs, désirables, appropriables. Le design a toujours été lié à ça. Mais on a voulu l’enfermer dans une boîte. Aujourd’hui, il essaie d’en sortir, pour redevenir un outil stratégique global.
Sans nouveaux imaginaires, on ne peut pas créer de nouveaux scénarios. Et sans nouveaux scénarios, on ne conçoit pas de nouveaux objets. Tout est lié.
Vous avez évoqué le design comme une méthode par hypothèses. À quelles étapes concrètes d’un projet cette logique se manifeste-t-elle ?
À l’école, on travaille sur une méthodologie en six phases. La phase zéro consiste à définir les règles du jeu : avec qui on va travailler, comment, dans quel cadre. Ensuite, on mène une enquête : observation, données, intuition. Puis vient la phase de création, qui repose sur des hypothèses, pas des certitudes. Ensuite, on teste.
Et là, un enjeu important émerge : comment mesure-t-on la performance d’un prototype, quand il n’est comparable à rien ? Il faut parfois inventer de nouveaux indicateurs. Un jour, dans un projet en EHPAD, j’ai proposé de ne plus mesurer l’autonomie des résidents, mais leur fierté. Tout a changé. Cela oblige à repenser les usages, les pratiques, les priorités.
Cela remet MÊME en question la manière de formuler un problème, NON ?
Exactement. Un bon indicateur révèle ce qu’on considère comme important. Il faut parfois changer la règle du jeu pour que les choses deviennent vraiment transformables. Par exemple, si on affichait des panneaux en ville avec une vitesse en mètre par seconde, je pense que les gens rouleraient plus lentement parce que d’un coup on a une conscience de la dangerosité de la vitesse immédiate.
Vous parliez tout à l’heure d’incarner des scénarios d’usage. Est-ce que c’est justement là que les scénaristes peuvent venir enrichir le travail des designers ?
Les designers pensent souvent en termes de persona, d’usagers-types. Mais ils n’ont pas toujours la finesse de trajectoire qu’apporte un scénariste. Le scénariste incarne. Il imagine une histoire singulière dans un cadre collectif. Croiser ces deux regards, c’est puissant : entre la macro-histoire et la micro-histoire.
Moi, je l’ai expérimenté avec Orange, sur la domotique. On a travaillé avec des scénaristes qui ont imaginé des courts métrages pour incarner différents usages de la technologie selon les profils familiaux. C’était très concret, très efficace.
Qu’est-ce que cette différence change dans un projet de design fiction ?
Je pense que ce que ne savent pas bien faire les designers, c’est justement de raconter : comment ? C’est quoi, l’histoire ? Les scénaristes n’écrivent pas la grande histoire, ils écrivent des trajectoires dans une grande histoire. Donc leur force, c’est de créer une narration à partir de contraintes technologiques ou sociales. De donner envie, de projeter, de rendre palpable. C’est une vraie complémentarité.
Si on reprend l’exemple avec Orange, les décideurs avaient besoin de voir la belle histoire pour que ceux qui ne comprennent rien au design, qui ne comprennent rien à la techno, se disent : « Ah ouais, on est à côté de la plaque… et on a oublié le facteur humain. » Les histoires peuvent aider un peu à démocratiser l’intérêt du design.
Un immense merci à Frédéric Lecourt pour cette discussion enrichissante !
Interviews d’experts et d’expertes de la prospective
Cet article est le premier de cette série. Retrouvez tous les épisodes ici.