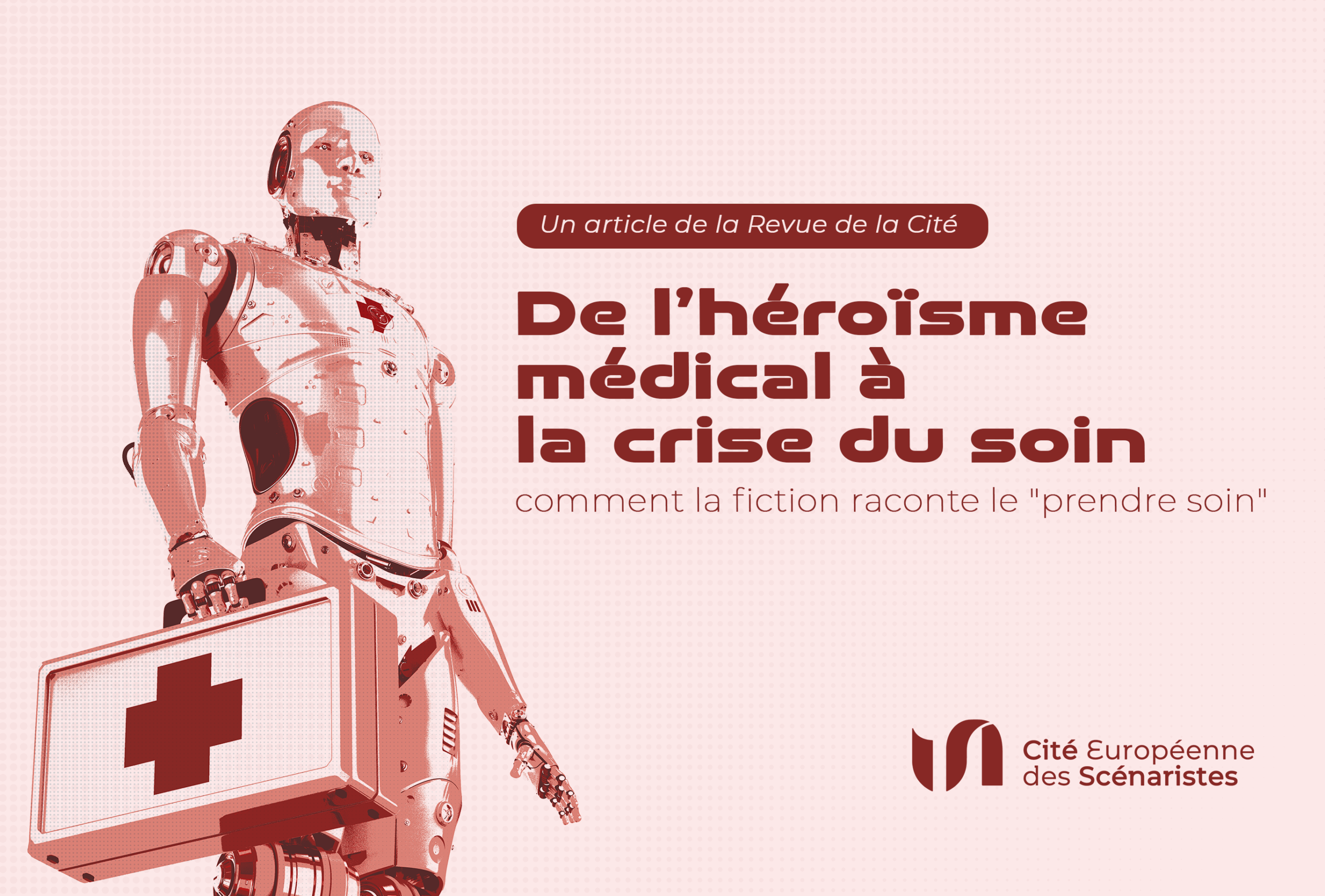Prendre soin. Deux mots qui semblent aller de soi, mais dont l’approche change au fil du temps et des histoires. Soigner un corps ? Un esprit ? Une relation ? Une société tout entière ? Les scénaristes explorent ces nuances depuis des décennies, révélant à travers leurs récits ce que chaque époque considère comme essentiel. Héroïsme médical, entraide silencieuse, soin empêché ou détourné… Chaque génération réinvente ce que « prendre soin » signifie à l’écran.
Retour sur ces représentations et sur ce qu’elles disent de nous.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe et les États-Unis se reconstruisent, portés par une foi inébranlable dans le progrès. Les progrès scientifiques – comme l’apparition des antibiotiques (la pénicilline par exemple) et des vaccins (contre la poliomyélite, développé dans les années 50) – transforment la médecine en un symbole d’espoir, et les institutions médicales deviennent des piliers de confiance. Les politiques de sécurité sociale naissantes, comme le National Health Service (NHS) au Royaume-Uni (1948) ou la création de la Sécurité sociale en France (1945), renforcent cette perception.
Dans cette période, les récits sur le soin valorisent souvent des figures héroïques – médecins ou infirmières – incarnant le progrès médical et le sacrifice personnel.
Les soignants comme figures héroïques et solitaires (1950-1970)
Ainsi, les récits des années 1950-70 placent souvent le soignant en figure centrale, presque mythifiée, souvent représenté comme un héros solitaire face à la maladie. Prendre soin est alors perçu comme une vocation sacrée, une mission personnelle où le sacrifice devient une vertu.
Aux Etats-Unis, des séries comme Le Jeune Dr. Kildare (1961) et Ben Casey (1961) montrent des médecins idéalistes, prêts à tout pour sauver leurs patients. Ces personnages incarnent une médecine centrée sur l’individu et sur le sacrifice personnel.
En France, Les Hommes en Blanc (1955, écrit par Maurice Aubergé, d’après le roman d’André Soubiran) illustre également cette figure héroïque.
Le film suit un jeune médecin dévoué, pris entre les exigences de sa profession et ses sacrifices personnels. Il reflète une époque où la médecine était encore perçue comme une vocation sacrée, presque religieuse, portée par une foi inébranlable dans le progrès et l’humanité.
Un autre exemple, plus symbolique, est La Symphonie Pastorale (1946, Jean Delannoy).
Bien que centrée sur un pasteur plutôt qu’un médecin, cette adaptation du roman d’André Gide explore la dimension spirituelle du soin. Le pasteur agit comme une figure de guide et de soignant moral envers une jeune femme aveugle, incarnant l’idée d’un appel sacré à prendre soin des plus vulnérables. Ce personnage incarne une vision du soin comme une mission individuelle empreinte de dévouement total.
Ces œuvres traduisent une époque où le soin est avant tout perçu comme un engagement individuel héroïque, empreint de sacrifice et de dévouement, reflet des attentes d’une société marquée par les séquelles de la guerre.
“Le soin est à la fois une pratique et une valeur, qui exige une attention constante aux besoins des autres et à la manière dont nos choix influencent leur bien-être”.
Joan Tronto, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (1993)
À cette époque, prendre soin, c’est avant tout répondre à un appel presque sacré : être là, coûte que coûte.
Mais les années 1980-90 marquent un tournant pour laisser une plus grande place à l’humanité des médecins, des patients, et de leur relation.
La relation humaine émerge (1980-2000)
L’épidémie de SIDA, en particulier, met en lumière les limites des systèmes de santé. Le soin ne peut plus être réduit à des gestes techniques. Il devient une affaire de relation, d’écoute, d’empathie. Les récits s’en font l’écho, explorant les liens complexes entre soignants et soignés : c’est durant cette période qu’ils évoluent pour représenter le soin comme un échange émotionnel.
Dans Philadelphia (1993, écrit par Ron Nyswaner), le film explore les préjugés et les discriminations subis par les malades du SIDA, tout en valorisant les soignants qui les accompagnent avec compassion.
Il en est de même pour Les Nuits fauves (1992, écrit par Cyril Collard et Jacques Fieschi), qui aborde les tensions sociales et sanitaires françaises liées à l’épidémie de SIDA.
Ici, le soin prend une dimension sociale et juridique : comprendre l’autre, c’est déjà prendre soin.
Dans un registre plus léger, Docteur Patch (1998, écrit par Steve Oedekerk), le médecin, incarné par Robin Williams, ne se contente pas de soigner : il redéfinit la pratique en y intégrant l’humour et la compassion. Chaque interaction devient un acte de soin émotionnel, bien au-delà du simple diagnostic.
Ces œuvres reflètent une prise de conscience croissante de la dimension sociale et psychologique du soin. Le soignant devient un confident, un partenaire dans les épreuves personnelles et collectives.
Ces récits montrent que le soin, c’est aussi créer un espace où l’autre peut se sentir vu et entendu. Une leçon que nos sociétés apprennent, parfois douloureusement.
Depuis 2000 : le soin systémique face à ses contradictions
“Les récits de santé, bien qu’ils semblent personnels, sont profondément politiques, car ils façonnent la manière dont nous percevons le soin et les responsabilités sociales”.
Paula Treichler, How to Have Theory in an Epidemic: Cultural Chronicles of AIDS (1999)
Le début du XXIe siècle est marqué par une série de crises des systèmes de santé : manque de moyens, épuisement des soignants et plus récemment, la pandémie de Covid-19.
Dans les récits contemporains, le soin est donc exploré dans toute sa complexité. Les œuvres mettent en lumière les tensions entre la dimension humaine du soin et les contraintes des systèmes institutionnels, souvent en crise.
Le soignant n’est plus seulement un héros ou un confident : il est pris dans un système qui le dépasse souvent.
Les récits critiques face aux systèmes de santé
Dans cette période, les œuvres interrogent autant les limites des systèmes que les dilemmes éthiques des soignants.
« Le care est une manière d’habiter le monde, de prendre en compte la vulnérabilité des autres et de redéfinir nos priorités sociales. »
Fabienne Brugère, L’éthique du care, 2011
Cette réflexion de Fabienne Brugère, philosophe, résume bien l’essence des récits contemporains, où le soin est exploré comme un acte collectif et éthique, au-delà de ses simples dimensions techniques.
Hippocrate (2014, Thomas Lilti) illustre parfaitement ces tensions, en explorant les dilemmes éthiques et les conflits internes des soignants. Les jeunes internes naviguent entre leurs aspirations et les contraintes d’un système de santé en crise. Le soin devient une bataille, non seulement contre la maladie, mais aussi contre la bureaucratie.
De son côté, La Fille de Brest (2016) met en lumière le combat d’Irène Frachon contre le scandale du Mediator, soulignant l’importance du soin et de l’éthique médicale.
Le soin devient un sujet collectif, où les récits interrogent les limites des systèmes et le poids des décisions éthiques.
« Le soin est une réponse à la vulnérabilité humaine, un acte qui engage la société tout entière à repenser ses priorités. »
Guillaume Le Blanc, Vivre ensemble : Une philosophie du commun, 2018
Un autre exemple marquant est La Fracture (2021, écrit par Catherine Corsini, avec la collaboration de Laurette Polmanss et d’Agnès Feuvre).
Situé dans un service d’urgence pendant une nuit de manifestations des Gilets Jaunes, ce film dépeint les soignants confrontés à un système saturé et sous-financé, tout en explorant les tensions sociales qui s’y reflètent. À travers une approche intimiste, il montre à la fois l’héroïsme et la fragilité des soignants, mais aussi la violence systémique qui pèse sur eux.
Ces récits reflètent une vision plus complexe du soin, où la technologie et l’organisation sont à la fois des opportunités et des contraintes ; le soin n’est plus une vocation individuelle : il devient collectif, systémique, et profondément politique.
Et en 2050 ?
2050 : Imaginer le soin dans un monde technologique
Dans un futur où les technologies médicales (IA, biotechnologies) seront omniprésentes, les récits pourraient explorer de nouvelles formes de soin. Mais à quelles conditions le soin peut-il rester humain ?
Des récits futurs pourraient montrer des soignants travaillant main dans la main avec des IA pour anticiper les maladies. Ces collaborations, aussi prometteuses soient-elles, posent des questions éthiques : peut-on déléguer l’empathie ?
Ces récits pourraient poser des questions clés : comment préserver l’humanité du soin dans un monde automatisé ? Quels dilemmes éthiques émergeraient face à des technologies capables de tout prédire ?