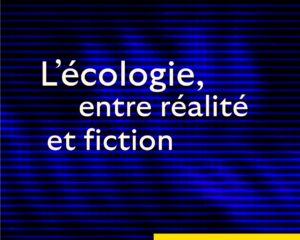Anatomie d’un succès est un concept de masterclass lancé en 2024 par la Cité européenne des scénaristes, pour donner la parole à celles et ceux qui fabriquent les succès du grand et du petit écran, en accordant une attention toute particulière au rôle-clé de l’écriture collaborative. Avec nos partenaires, nous souhaitons montrer que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles se construisent à plusieurs mains.
Cette dissection des succès s’appuie sur le regard croisé de plusieurs professionnels intervenant aux différentes étapes de la fabrication du film ou de la série : scénaristes, producteurs et productrices, réalisateurs et réalisatrices, comédiens et comédiennes. La masterclass donne la parole à chacun, à chacune et permet de mettre aussi bien en lumière les réussites, que les défis de la création à plusieurs.
Nous remercions chaleureusement notre partenaire Studio TF1, Benjamin Andrey, Directeur général adjoint Fiction et Céline Moreira, directrice littéraire, de nous avoir donné l’opportunité de créer cette nouvelle édition d’Anatomie d’un succès autour de la série Askip, produite par Amsto (Studio TF1) et diffusée par France Télévisions.
Un grand merci à Fabien Suarez, scénariste et vice-président de la Cité européenne des scénaristes, de tenir ce rôle précieux d’animateur dans chacune de nos masterclass Anatomie d’un succès.
Et un immense merci à Benoît Masocco, créateur et producteur de la série, Juliette Barry, scénariste et directrice de collection et Manon Balasuriya, comédienne, qui nous ont livré une discussion passionnante autour d’Askip !
Le parcours de nos invités : Askip, une série de fiction nourrie par la réalité
Askip est lancée en 2020 sur Okoo, la plateforme de streaming dédiée aux contenus jeunesse de France Télévisions et sur France 4. Elle compte à présent 345 épisodes répartis sur 6 saisons et cumule pas moins de 36 millions de vues depuis sa première diffusion. En se concentrant sur le quotidien d’un collège fictif, traitant des remous du passage de l’enfance à l’adolescence, Askip parvient à séduire durablement le public pré-ado/ado français.
Benoît et Juliette ont tous deux grandi loin du cinéma et de l’audiovisuel. Assez vite intéressés par l’écriture, ils passent cependant plusieurs années à chercher leur voie : Benoît, en tant que journaliste puis producteur d’émissions pour M6 et Juliette, comme comédienne puis assistante de production.
« Je crois qu’on est avant tout riche du parcours qu’on a, et plus notre parcours est chaotique, plus le bagage est riche ».
Benoît MASOCCO
Après son passage par la production, Benoît rejoint CAPA Drama, société de production de documentaires et filiale de Studio TF1. Une expérience déterminante, qui l’incite à se tourner vers l’écriture.
« Je suis resté une douzaine d’années chez CAPA à réaliser et surtout produire des documentaires et tout à coup s’est présentée l’opportunité de faire la bascule vers la fiction. Tout ce que j’avais fait jusque-là, les émissions de divertissement et bien sûr le documentaire, ont nourri mon écriture. »
Benoît MASOCCO
Pour Juliette, son sens de l’organisation et la richesse de ses expériences professionnelles passées – elle a, entre autres, une formation en architecture – lui servent quotidiennement dans son métier :
« En parallèle de mon métier, je fais des formations, j’accompagne beaucoup d’étudiants, dont ceux de la Cité européenne des scénaristes sur Askip et j’enseigne à l’EICAR et au CEEA. Je suis très scolaire. J’adore la structure, ça m’aide pour l’écriture de scénario. »
Juliette BARRY
LES CONTRAINTES CRÉATIVES
« À un moment, soit on est écrasés par le poids des contraintes, soit on se dit tiens, on va les utiliser comme des atouts et jouer avec. »
Benoît MASOCCO
Aux origines d’Askip : une envie de Benoît Masocco et de CAPA Drama, inspirés par la série américaine The Office, de tester la « scripted reality » – format de série à mi-chemin entre la téléréalité-réalité et la fiction-. Dans le même temps, en cette fin des années 2010, France Télévisions lance Okoo et cherche un contenu adapté aux 9-13 ans, qui permette d’aborder les grands questionnements inhérents à cette tranche d’âge. Askip est donc pensée comme un hybride de fiction et de documentaire1 et relate l’arrivée d’une équipe de télévision au collège (fictif) François Truffaut pour filmer, au quotidien, la vie des élèves et des professeurs.
Une fois ce concept posé, s’ouvre la phase d’écriture de la première saison, marquée par d’importantes contraintes budgétaires, le diffuseur n’étant pas certain du succès de la série :
« Notre budget était environ trois à quatre fois inférieur à celui des feuilletons quotidiens. Nous n’avions pas le choix, il fallait être capable d’écrire avec cette contrainte. Pour nous, la base de toute production, c’est d’avoir des histoires bien écrites et bien jouées. Pour le reste, on mise sur la débrouille : au tournage, avec les accessoires, en post-production. »
Benoît MASOCCO
Ecrire pour les pré-ados, un processus créatif sensible
Askip vise un public pré-adolescent, que les diffuseurs peinaient jusqu’alors à cibler : les 9-13 ans. La série réussit donc non seulement à toucher une tranche d’âge laissée de côté, mais également à proposer un format, la prise de vues réelles, plus souvent réservé au public Young Adult. Cela lui permet de s’imposer comme la référence de la série collège, qui aborde habilement et avec beaucoup de réalisme, les sujets de préoccupation des pré-ados.
Ecrire pour ce public n’est cependant pas exempt de contraintes et suppose une grande vigilance de la part des scénaristes et de la directrice de collection Juliette Barry. Les sujets abordés peuvent être très sensibles, obligeant les auteurs à jongler entre réalisme et pudeur, comme le montre l’extrait choisi pour la masterclass, tiré du 15ème épisode de la sixième saison « Le jour des oiseaux » :
« La contrainte principale de notre série c’est que les 66 épisodes d’une saison se passent dans le collège et abordent chacun un grand sujet de société, traité à hauteur d’enfant. Notre âge cible se situe autour de 11/12 ans, mais il faut que le petit frère ou la petite sœur puisse regarder aussi ; France Télévisions est d’ailleurs très vigilant là-dessus. Dans cet épisode (ndlr : S6E15), le personnage joué par Manon Balasuriya se fait avoir par un mauvais directeur de casting. Elle lui envoie des photos d’elle en maillot de bain, que les garçons du collège récupèrent et projettent. C’est un sujet grave, qu’il fallait aborder correctement. »
Juliette BARRY
La dimension fortement documentaire d’Askip implique une veille de la part des scénaristes, qui doivent se tenir informés des sujets d’actualité pour les adolescents et des éventuelles demandes de leurs jeunes téléspectateurs :
« Il y a deux sources essentielles pour rester dans l’air du temps, et les comédiens en font partie. Mine de rien, même s’ils ont seize ou dix-sept ans pour la plupart, la période collège est beaucoup plus proche d’eux que pour nous. Il y a aussi les réseaux sociaux, sur lesquels nos abonnés nous demandent d’aborder tel ou tel sujet, qui correspond à leurs préoccupations. »
Benoît MASOCCO
Un rythme d’écriture soutenu et une production efficace
Six auteurs et autrices ont travaillé sur la première saison d’Askip, dans un contexte particulier dû au COVID. Ils sont alors répartis en deux ateliers et écrivent 20 épisodes en un bloc. Depuis, Askip a adopté un rythme de production très similaire à celui des quotidiennes : la saison en cours n’est pas encore finie que l’équipe travaille déjà sur la suivante, comme l’explique Juliette Barry :
« C’est vraiment à partir de la saison 3 qu’il a fallu s’organiser, presque comme sur une quotidienne. On fait une saison et demie par an. Avant même d’avoir fini une saison, on repart sur celle d’après et on essaie de tourner en permanence, que ce soit à la postproduction, à l’écriture ou sur le tournage. Ça ne s’arrête jamais. »
Juliette BARRY
Désormais, Askip fonctionne en rooms2. Les auteurs – environ cinq ou six pour une saison complète – se retrouvent lors d’ateliers d’une durée de trois mois, au cours desquels ils trouvent les intrigues et écrivent une dizaine d’épisodes. Chaque room se compose de deux directeurs d’écriture – dont Juliette Barry, en contrat depuis la saison 2 – et un coordinateur ou une coordinatrice d’écriture. Chaque directeur d’écriture est responsable de 33 épisodes tandis que le/la coordinateur/coordinatrice d’écriture gère les plannings, fait le lien entre les deux directeurs d’écriture. Son rôle est aussi de vérifier que les contraintes de production sont bien respectées (nombre de pages, nombre de séquences, contrainte de scènes sans figurants obligatoires, etc.). L’écriture de chaque épisode suit un découpage en trois intrigues systématiques : une grande intrigue (intrigue A) sur un sujet de société – ça peut-être le racisme, l’homophobie, le harcèlement -, une intrigue feuilletonnante (intrigue B) qui aborde les problèmes quotidiens des adolescents – leurs relations familiales, amicales, amoureuses – et l’intrigue « comédie » (intrigue C).
Le fonctionnement en rooms permet aux auteurs de trouver l’inspiration à travers leurs échanges, le partage d’anecdotes personnelles. Tenir un rythme soutenu de 66 épisodes par saison, avec trois intrigues par épisode, suppose en effet d’aller chercher l’inspiration bien au-delà des poncifs de l’adolescence.
« En room, les auteurs viennent avec de la matière, des articles de journaux, des choses qui nous inspirent et des histoires personnelles bien sûr. On fait des tours de table. C’est à partir de nos échanges qu’on construit une intrigue avec un début, un milieu et une fin, et que découlent nos intrigues A, B et C. »
Juliette BARRY
Aux 66 épisodes, d’une durée de treize minutes, que compte chaque saison, s’ajoutent un podcast fiction diffusé pendant les vacances scolaires et un épisode spécial, diffusé à Noël ou pendant Halloween. Les tournages ont lieu pendant les vacances – ce qui permet aux comédiens de poursuivre une scolarisation normale – et chaque saison est diffusée sur le temps d’une année scolaire, ce qui renforce l’effet de réel. Cette spécificité suppose donc une organisation précise dès la phase d’écriture, pour respecter les temps impartis.
Askip, tremplin des jeunes auteurs et autrices
Les scénaristes sont régulièrement rejoints par de jeunes talents qui apprennent à leurs côtés, dans ce contexte très particulier d’une série pour pré-ados quasi quotidienne. Pour certains d’entre eux, c’est la porte d’entrée vers un contrat de coordinateur/ coordinatrice d’écriture ou d’auteur/autrice sur la série :
« Avec la Cité européenne des scénaristes, on accueille régulièrement un ou une apprenante avec nous, qui est en observation pendant les trois mois d’atelier. Il ou elle lit énormément de choses, on le/la forme à l’écriture de scénario. Les deux apprenants qu’on a eu ont été embauchés sur Askip pour écrire un épisode sur la saison où ils étaient avec nous3. Tous les ans, on a un coordinateur d’écriture qui passe auteur ensuite. »
Juliette BARRY
la relation au diffuseur
« On fonctionne en direct avec France Télévisions avant de construire les épisodes, c’est une écriture très contrainte. »
Juliette BARRY
France Télévisions, qui diffuse Askip depuis sa création, joue un rôle déterminant dans l’écriture. Le rythme soutenu que la série suit suppose une forte présence du diffuseur pour permettre aux auteurs d’avancer. La gravité de certains sujets abordés et le jeune âge du public-cible rendent sa présence nécessaire dans le processus créatif, y compris dans la création des personnages :
« C’est Benoît qui crée les nouveaux personnages. Ils sont ensuite validés par France Télévisions. En ateliers, on s’occupe de créer leurs arches, de les faire évoluer ».
Juliette BARRY
Un casting et un tournage exigeants
Avec six saisons au compteur et une septième annoncée pour septembre 2025, Askip réunit chaque année des dizaines de jeunes comédiens professionnels et non-professionnels. L’étape du casting est cruciale et récurrente, de nouveaux talents rejoignant régulièrement la série en remplacement des anciens, afin de restituer le rythme d’un collège qui voit les promotions d’élèves défiler.
“On voulait vraiment un truc qui sente la vie. Il y a eu un énorme travail de casting pour la saison 1, qui a duré pendant des semaines et des semaines.”
Benoît MASOCCO
Le fait qu’Askip suive un rythme de production quasi continu représente une contrainte de taille pour les auteurs, qui ne terminent l’écriture d’une saison qu’une fois le casting passé.
« Les castings arrivent toujours trop tard ! Les comédiens que l’on trouve nous inspirent d’une année sur l’autre, d’une saison sur l’autre. Le comédien est choisi par rapport au rôle mais on s’adapte à lui, on s’inspire souvent de sa vie, de choses qui lui sont arrivées. »
Juliette BARRY
« Dans un monde parfait, il faudrait qu’on lance les castings bien avant l’écriture mais nos comédiens sont très jeunes et donc assez volatiles. Si on les booke trop tôt, ils risquent d’être pris sur une autre série, un film, et il faut tout recommencer au dernier moment. »
Benoît MASOCCO
Cette spécificité de la série, qui pourrait représenter une énorme contrainte pour les auteurs, se transforme régulièrement en atout. Les scénaristes s’inspirent de la personnalité des comédiens pour enrichir leurs personnages et renouveler les intrigues. L’épisode 60 de la saison 3, « le jour en-chanté », en est le parfait exemple. Devant répondre à une commande spéciale de France Télévisions pour la Fête de la musique, l’équipe d’écriture bloque…Le budget est restreint, ils ne peuvent pas faire appel à des chanteurs ou des chorégraphes professionnels. Jusqu’à se souvenir que l’un des comédiens, Bastiaan Van Leeuwen, qui incarne Dorian, est passionné de comédie musicale et qu’à lui seul, il pourrait être le moteur de cet épisode spécial.
« Toutes les chorégraphies ont été improvisées, j’ai fait appel à un compositeur qui a accepté de composer gratuitement, j’ai écrit les paroles des chansons. Les figurants étaient incroyables. Il y avait une énergie de dingue. Cet épisode est assez représentatif de ce qu’est Askip et de ce que j’ai appris en commençant au cinéma : pour faire notre métier, il faut de grandes qualités humaines et beaucoup, beaucoup de scotch. »
Benoît MASOCCO
Pour autant, et malgré les contraintes inhérentes à son format, l’aventure Askip est plus que lancée, avec une septième saison annoncée pour le 5 septembre 2025. Elle est l’exemple d’une série qui a su s’insérer dans un marché incertain, devenir la référence des pré-ados et ados français, et dont le succès continue à surprendre son créateur :
« Le plus beau compliment qu’on puisse me faire, c’est par exemple une régisseuse qui cet été m’a dit “j’étais hyper contente de bosser sur une série que j’aurais voulu voir ado”. Les plus beaux retours ce sont ceux de nos spectateurs qui se reconnaissent dans la série, qui trouvent en elle le réconfort nécessaire, comme ce jeune qui m’a confié : “J’étais harcelé, et votre série m’a fait du bien, ça m’a permis de tenir, de me rendre compte que je n’étais pas seul”. D’une certaine façon, Askip est née d’un accident, elle n’était pas destinée à être une série, ça n’aurait pas dû se passer comme ça, il n’y aurait pas dû avoir autant de saisons. Ce succès nous surprendra toujours un peu ».
Benoît MASOCCO
Nous remercions chaleureusement nos invités pour leur générosité et la richesse de cette discussion. A très vite pour de nouvelles masterclass !
Dans le cadre de nos masterclass Anatomies d’un succès, nous mettons à votre disposition des comptes-rendus de ces rencontres, des ressources précieuses pour celles et ceux qui souhaitent se former ou simplement découvrir les coulisses d’un film ou d’une série qu’ils ont aimé.
ANATOMIE D’UN SUCCÈS : LA FLAMME / LE FLAMBEAU
(avec Jonathan Cohen, Stéphane Drouet, Benjamin Bellcour et Jean-Toussaint Bernard)
ANATOMIE D’UN SUCCÈS : MIRACULOUS
(avec Thomas Astruc, créateur de la série, et Sébastien Thibaudeau, directeur d’écriture)