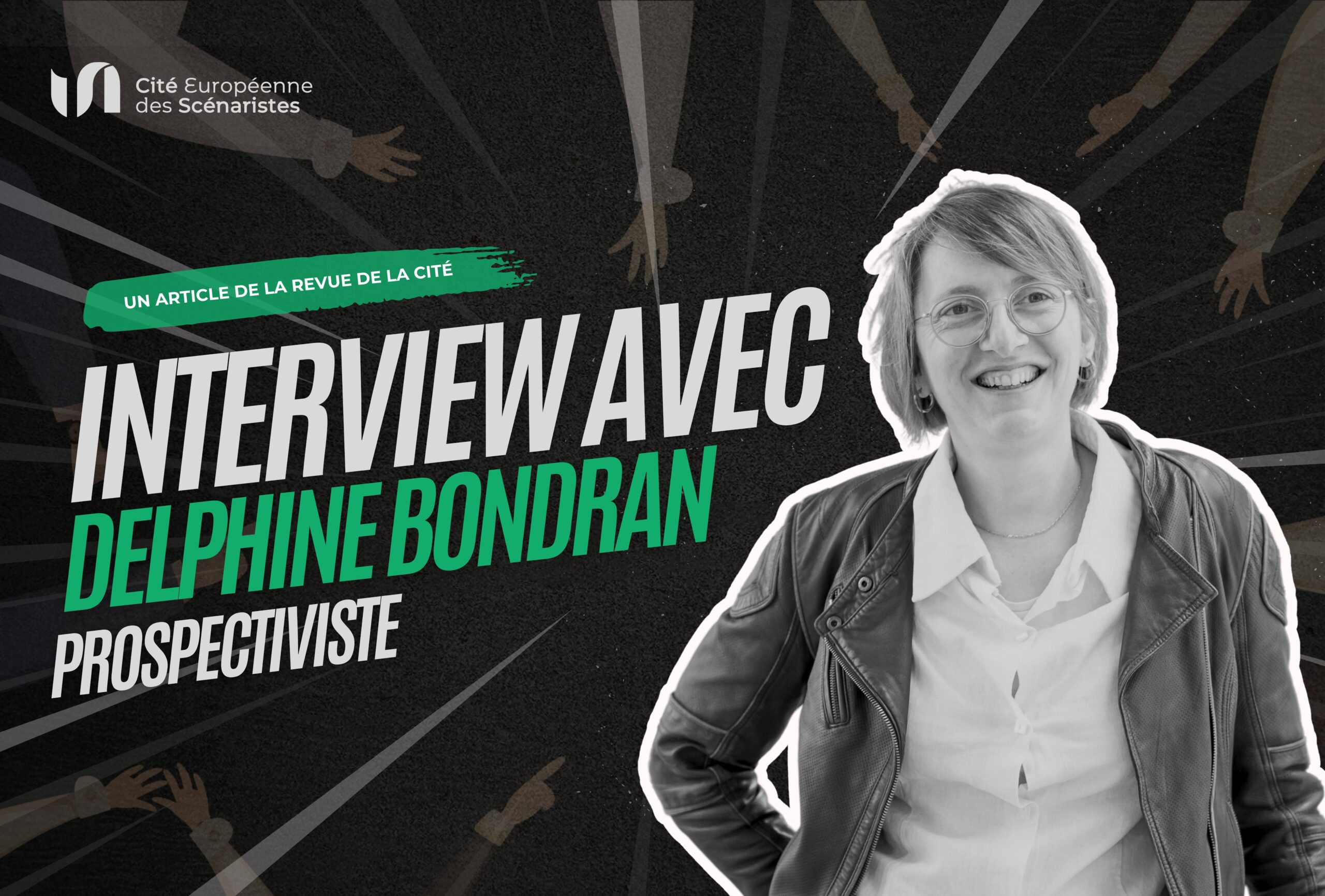Delphine Bondran conçoit et anime des dispositifs de prospective participative pour des collectivités et des organisations depuis 2020. Elle s’attache notamment à outiller les plus jeunes à imaginer le futur et à faire face à l’incertitude. Elle a ainsi dispensé la masterclass Prospective du concours Butterfly 2050, en partenariat avec la Cité Européenne des Scénaristes. Elle intervient aussi à l’EM Lyon pour le module de prospective « Futurs Durables » et est l’autrice d’un cahier de prospective pour les enfants de la Ville de Beauvais.
Voici notre conversation avec elle.
Vous accompagnez des collectifs dans l’exploration du futur à travers des récits et des dispositifs d’intelligence collective. Quel rôle joue, selon vous, l’imaginaire dans notre façon de percevoir le monde et d’envisager l’avenir ?
Je crois beaucoup au pouvoir des histoires et de l’imagination. Les contes pour enfants, les films ou les jeux vidéo racontent nos représentations de la société, ce qui nous fait peur, nous fascine et nous émeut. Les récits façonnent aussi nos imaginaires et nous donnent accès à d’autres mondes, à d’autres vies que la nôtre.
En changeant de perspective, en faisant un détour par la fiction, on élargit notre champ des possibles.
C’est particulièrement flagrant en science-fiction, où l’on se projette dans le futur en explorant des hypothèses ou en extrapolant le présent.
Comment êtes-vous PARVENUE à faire de cette facilitation de l’imaginaire votre métier ?
Mon premier travail en tant que consultante, il y a 20 ans, consistait à écrire des scénarios de crise pour entraîner des cellules de crise. Il fallait imaginer des situations plausibles, adaptées aux contextes géographique et organisationnel. C’était déjà une exploration fictionnelle de futurs possibles. Puis j’ai accompagné des transformations dans des organisations et évalué des politiques publiques. Là, je faisais aussi des scénarios, ou de la simulation d’organisations du travail ou de nouveaux services avec les équipes concernées. C’est au cours d’une formation en co-design et intelligence collective que j’ai découvert le design fiction. J’ai été frappée par la puissance de cet outil et j’ai su que c’était ce que je voulais faire.
Et aujourd’hui, vous l’utilisez dans vos ateliers aux côtés de l’intelligence collective. Pouvez-vous définir ces approches et expliquer comment vous les intégrez concrètement dans vos dispositifs ?
Aujourd’hui, je fais de la prospective participative. Mon travail consiste à mobiliser les capacités fabulatrices, les aspirations, les craintes et les connaissances de différents publics pour envisager et explorer des futurs à plusieurs. C’est là qu’intervient l’intelligence collective. La méthode est façonnée en fonction du sujet, du public concerné et selon le temps disponible. Les démarches itératives permettent d’aboutir à des explorations plus fines des futurs.
Le design fiction, c’est la matérialisation de cette exploration. On crée un objet fictionnel qui représente et donne à voir le futur exploré, comme si on y était. Ce peut être une affiche, une offre d’emploi, un ticket de caisse… C’est beaucoup plus tangible que « Demain, notre ville sera végétalisée » et cela permet à tout un chacun – y compris quelqu’un qui n’a pas participé à la démarche d’exploration – de s’imaginer dans ce futur et de donner son avis sur cette orientation. L’objectif de la prospective participative étant aussi de créer du débat.
Quels sont justement les principaux défis pour inciter les participants à s’engager dans ces ateliers prospectifs ?
Un des premiers défis, c’est déjà de mobiliser et d’inciter les personnes qu’on n’entend pas ou peu à participer à la réflexion et aux ateliers. Dans les collectivités, c’est un travail en partenariat avec les agents des services publics et les associations qui nous permet d’aller vers ces publics. La présence dans l’espace public, à la rencontre des personnes et de leurs occupations (et pré-occupations) nous permet aussi d’élargir le champ de vision.
Avez-vous dû adapter votre approche pour certains publics ?
Bien sûr, par exemple, pour intéresser les adolescents à participer à la démarche “Imaginons Beauvais en 2040”, nous nous sommes appuyés sur leurs références culturelles : quels films, quelles séries, quels jeux vidéo ont influencé leur vision du futur ? À partir de là, nous avons pu construire et explorer avec eux des hypothèses sur le futur de la ville (”plutôt Avatar, Divergente ou Futurama ?”).
Et quels formats narratifs utilisez-vous le plus souvent dans vos ateliers ?
Cela dépend du temps disponible et du public. Par exemple, l’un des formats courts qui fonctionne bien chez Futurs Proches1 est celui du micro-récit : une courte nouvelle ou un journal de bord, qui est produit en groupe de 3 à 5 personnes, en 2 à 3 heures. Après avoir permis aux participants de s’immerger et de se situer dans une hypothèse de rupture, – « Et si, en 2050, il n’y avait plus de supermarché ? » – on les invite à travailler vraiment la narration. Il leur faut un personnage, une situation initiale, un déroulement clair. À l’issue de l’atelier, le groupe a construit un récit sur une demi-page, voire une page
L’objectif de ces récits est de s’immerger dans le futur, de le faire vivre au travers d’un personnage (pas forcément humain d’ailleurs) de ce futur imaginé : qu’aperçoit-il en ouvrant la fenêtre ? Que ressent-il ?
Ce zoom constant, entre une vision macro et l’expérience individuelle, permet d’éviter un futur trop abstrait et de rendre les récits plus engageants.
Ça marche aussi pour des objets visuels (panneaux de signalisation, etc.), qui racontent, eux aussi, une histoire du futur.
Quelles sont les principales résistances rencontrées par les participants lorsqu’il s’agit d’imaginer le futur ?
On a tous des biais cognitifs, dont la rationalité, qui nous font imaginer le futur comme un prolongement du présent. Pour certains publics, c’est a priori très difficile de s’affranchir du réel et d’imaginer quelque chose d’improbable, quand bien même cela repose sur des tendances ou des signaux faibles observés. On peut entendre : “non mais c’est pas possible” ou “ça n’arrivera jamais”. Or, justement, l’un des objectifs de la prospective, c’est d’aller explorer cet improbable, le cygne noir auquel on ne croit pas tant qu’on ne l’a pas vu.
Il faut pouvoir mettre les personnes présentes en confiance, par rapport à l’exercice d’imagination où il n’y pas de bonne ou mauvaise réponse et par rapport au travail collectif.
Et justement, quelles sont vos méthodes pour réussir à les amener dans cette zone de confiance ?
L’une des premières stratégies consiste à introduire un décalage dès la première séquence des ateliers. Il s’agit soit de les plonger immédiatement dans un exercice créatif, soit de les confronter à un point de vue inattendu qui stimule leur imagination. L’idée est de montrer qu’il n’y a pas d’attente rigide, que l’on est là pour expérimenter, et que tout le monde peut contribuer à la construction du récit.
Un autre aspect essentiel est le travail du collectif. Imaginer seul et imaginer à plusieurs sont deux choses très différentes, et cela ne va pas de soi pour tout le monde. Il faut donc structurer la collaboration avec des méthodes adaptées : comment faire en sorte que les idées circulent efficacement ? Comment éviter qu’un participant prenne trop de place dans le groupe tandis que d’autres se mettent en retrait ? Selon le temps dont on dispose, la dynamique évolue. Dans des ateliers courts, comme ceux de trois heures, il faut rapidement avancer vers une proposition collective. Dans des ateliers itératifs, chaque groupe arrive à un moment différent du processus, soit pour s’inspirer, analyser du matériau et imaginer tous azimuts, soit pour créer et matérialiser une hypothèse, soit pour la questionner…
Pourquoi est-il essentiel, selon vous, d’incarner un point de vue précis dans les récits prospectifs ? Quels sont les freins et les bénéfices de cette approche ?
Si on veut voir comment se passe le futur, il faut pouvoir décrire les paysages, le fonctionnement de la société, les grands événements qui ont conduit à cette situation. Cela nous donne une vision d’ensemble du futur imaginé.
Mais c’est très important aussi de voir ce qui se passe à l’échelle des acteurs et des « habitants » de ce futur imaginé. Avoir des points de vue incarnés permet de nous mettre à l’échelle des perceptions et des préoccupations : qu’est-ce que telle personne du futur entend ? voit ? sent ? Qu’est-ce qui est super important pour elle ? À quoi fait-elle particulièrement attention ? C’est ce qui va rendre le récit prospectif riche et tangible.
En revanche, choisir un seul point de vue peut aussi limiter notre vision du scénario envisagé. C’est aussi important de diversifier ces points de vue, de se mettre tant à l’échelle d’une enfant de 8 ans du futur, qui n’a connu 2025 qu’au travers des récits de ses parents par exemple, qu’à l’échelle d’un dirigeant d’une entreprise ou d’un agent public, et pourquoi pas à l’échelle d’une colonie de fourmis.
En combinant plusieurs situations et personnages, on obtient une vision plus nuancée et plus plausible de ce que pourraient être les futurs possibles.
Pensez-vous que les scénaristes PUISSENT apporter une valeur ajoutée à ce processus ? Avez-vous déjà collaboré avec eux sur ce type de démarche ?
Il y a de plus en plus d’initiatives où des scénaristes travaillent avec des chercheurs ou des militaires pour imaginer des futurs possibles. Pour ma part, je n’ai pas eu l’occasion de collaborer avec des scénaristes jusqu’à présent, mais je suis convaincue de l’intérêt de s’appuyer sur leurs capacités à imaginer des situations, à incarner et faire vivre des émotions et, aussi, à rendre cohérent un récit et un univers dans leur ensemble. D’ailleurs, je me forme régulièrement à diverses méthodes d’écriture, car je trouve que cela nourrit énormément mon travail.
Je pense aussi que les méthodes collaboratives utilisées par les scénaristes, notamment sur les séries et en particulier sur les productions quotidiennes, pourraient être utilisées dans les projets prospectifs.
Je connais moins cet aspect-là mais il y a un caractère itératif dans la manière de construire une histoire en continu, de tester, d’ajuster et de s’adapter à la dynamique narrative, de travailler et d’imaginer à plusieurs, qui pourrait certainement être transposée à l’élaboration collaborative de scénarios prospectifs.
Selon vous, pourquoi la prospective ne fait-elle pas encore appel de manière systématique aux scénaristes ?
Peut-être une question de culture professionnelle ? On n’aborde pas la fiction par le même côté. En prospective, on s’appuie beaucoup sur des expertises techniques et scientifiques ou sur l’observation de signaux porteurs de changement. On a beaucoup de prospectivistes qui sont des ingénieurs, des designers, des anthropologues… Tous les scénarios prospectifs ne sont d’ailleurs pas mis en récit. Et c’est sans doute là que ces deux métiers gagneront à se connaître et à travailler davantage ensemble.
Interviews d’experts et d’expertes de la prospective
Cet article est le deuxième de cette série. Retrouvez tous les épisodes ici.