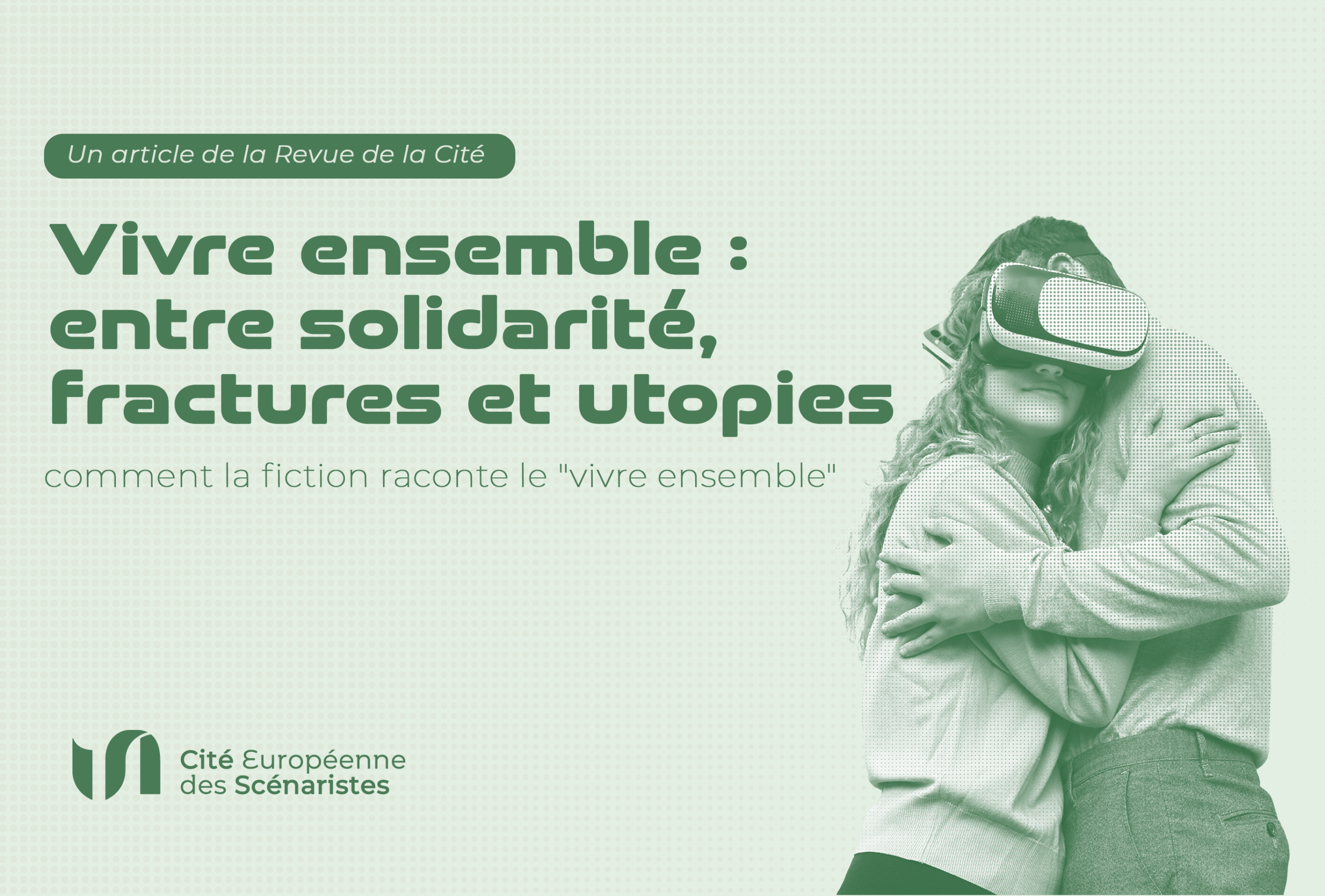Un immeuble, une panne d’ascenseur, et voilà tout un microcosme obligé de se parler. La fiction adore ces huis clos forcés, ces moments où le “vivre ensemble” cesse d’être un slogan pour devenir une épreuve concrète. Entre entraide sincère et clashs violents, elle met à nu ce qui nous unit… et ce qui nous sépare. Des grandes fresques fraternelles des années 1950 aux récits plus fragmentés d’aujourd’hui, en passant par les utopies de demain, cet article explore comment les récits fictionnels façonnent — et questionnent — notre envie de faire société.
1950-1970 : l’unité nationale, entre idéal et illusions
Les récits de l’après-guerre traduisent des sociétés en quête d’unité. Marquées par les traumatismes du conflit mondial et les bouleversements de la décolonisation, elles valorisent la solidarité nationale comme rempart contre les crises. L’entraide devient une valeur centrale, portée à la fois par les politiques publiques et la fiction.
L’entraide face aux crises
Dans les années d’après-guerre, les récits mettent souvent en avant l’entraide comme un moyen de surmonter des crises collectives. Ces œuvres valorisent la force collective face à des adversités extérieures.
On pense notamment au Salaire de la Peur (1953, écrit par Henri-Georges Clouzot et Jérôme Geromini) ou encore La Traversée de Paris (1956, écrit par Jean Aurenche et Pierre Bost), qui racontent tous deux comment des hommes de milieux sociaux différents sont contraints de s’entraider contre l’adversité.
Mais le grand film du vivre-ensemble de cette période est La Grande Vadrouille (1966, écrit par Gérard Oury, Danièle Thompson et Marcel Jullian). Le film illustre cette dynamique en mettant en scène un peintre en bâtiment (Bourvil) et un chef d’orchestre (Louis de Funès) contraints de collaborer pour échapper aux nazis. Le film célèbre une solidarité dépassant les différences sociales, unissant les Français autour d’un objectif commun, et connaît un succès phénoménal avec plus de 17 millions1 d’entrées en France, record du plus grand nombre d’entrées pour un film, tenu pendant 41 ans.
Mais Jean-Pierre Rioux nuance cette représentation quasi-idyllique dans La France de la Quatrième République (1987) :
“Le vivre ensemble des récits d’après-guerre est souvent idéalisé, mais il porte en germe les critiques des décennies suivantes.”
Cette remarque nuance la vision optimiste de l’époque, rappelant que la solidarité célébrée dans les récits d’après-guerre masque souvent les tensions sociales et économiques croissantes liées à la décolonisation, aux migrations et à l’urbanisation.
On pense par exemple à Un homme de trop (1967, Costa-Gavras), où un groupe de résistants recueille un mystérieux prisonnier évadé. Alors que leur unité est censée être leur force face à l’ennemi, l’arrivée de cet inconnu sème la discorde et ébranle la cohésion du groupe. Le film illustre comment la solidarité, pourtant essentielle en temps de guerre, peut être mise à l’épreuve par la méfiance et les tensions internes.
Ce vivre-ensemble, d’abord présenté comme un idéal, commence ainsi à être questionné, notamment à travers les tensions croissantes liées aux mutations sociales.
1970-1990 : la fin de l’illusion et la mise en scène des fractures sociales
À partir des années 70, les récits abandonnent progressivement l’image d’un vivre-ensemble évident pour interroger les inégalités et tensions qui structurent la société. Le cinéma social commence à s’emparer de ces sujets, en particulier à travers la représentation des tensions entre communautés et la fragmentation des sociétés.
Dans Dupont Lajoie (1975, Yves Boisset), un féminicide commis dans un camping révèle le racisme ordinaire d’une classe moyenne persuadée de défendre son mode de vie. Le film, glaçant, montre une société où la xénophobie se dissimule sous le vernis du quotidien, minant toute idée d’unité nationale.
Par la suite, les années 1980 voient émerger de nouveaux récits, plus ancrés dans les difficultés socio-économiques, qui se font l’écho des interrogations de la jeunesse urbaine.
Dans Neige (1981), réalisé par Juliet Berto et Jean-Henri Roger, le quartier de Pigalle devient le théâtre d’un microcosme où coexistent drogués, dealers, policiers et figures de la nuit. Le film explore une forme de vivre-ensemble brut et instable, fondé sur la débrouille et la solidarité entre marginaux.
Un monde sans pitié (1989, écrit par Éric Rochant), dépeint également une jeunesse urbaine désenchantée, confrontée à l’individualisme et au manque de perspectives. Le vivre-ensemble est souvent mis en échec par la violence structurelle et l’absence de perspectives, annonçant les tensions sociales qui seront au cœur du cinéma des années 90, notamment avec La Haine (1995, écrit par Mathieu Kassovitz).
À travers le quotidien de trois jeunes hommes issus de la banlieue parisienne, le film dépeint les fractures sociales et raciales, tout en exposant les limites du vivre-ensemble dans une société marquée par l’exclusion et la violence. Une scène emblématique est le monologue de Hubert sur « la chute », qui illustre le désespoir et l’incapacité des personnages à échapper à leur environnement.
Depuis 2000 : célébrer la diversité et les micro-communautés
Avec l’accélération de la mondialisation et les débats sur le multiculturalisme, les récits des années 2000 adoptent une vision plus nuancée et (parfois) optimiste – du vivre ensemble.
La diversité devient un moteur narratif, source de richesse et de conflits. Les débats autour du multiculturalisme, des droits civiques et des crises migratoires redéfinissent les notions de diversité et de coexistence.
“Vivre ensemble, c’est apprendre à créer un espace où les différences ne se neutralisent pas, mais se complètent pour enrichir le collectif.”
Guillaume Le Blanc, Vivre ensemble : Une philosophie du commun (2018)
Certains récits célèbrent la rencontre entre individus issus de milieux différents, tandis que d’autres insistent sur la persistance des fractures sociales et culturelles.
D’un côté, des films comme Intouchables (2011, écrit par Olivier Nakache et Éric Toledano) mettent en scène un vivre-ensemble apaisé, où les différences sociales et culturelles deviennent une source d’enrichissement mutuel. Les Invisibles (2018, écrit par Louis-Julien Petit, Claire Lajeunie et Marion Doussot) met en lumière la solidarité concrète au sein d’un système en crise, en suivant des travailleuses sociales luttant pour réinsérer des femmes sans domicile.
De l’autre, tout un pan du cinéma français reprend le flambeau de « cinéma de banlieue »2 né dans les années 90 : un cinéma qui s’attache à montrer les failles du vivre-ensemble, en exposant les tensions qui existent dans une société marquée par des inégalités persistantes.
Des films comme Les Misérables (2019), Bac Nord (2021) et Athéna (2022) en sont un exemple, révélant une fracture sociale persistante entre quartiers populaires, forces de l’ordre et institutions. Les Misérables explore la méfiance mutuelle entre jeunes de banlieue et police, où la violence semble parfois inévitable. Bac Nord, en adoptant le point de vue des policiers, interroge la fine limite entre maintien de l’ordre et abus de pouvoir dans des territoires sous tension. Athéna, enfin, radicalise cette thématique en imaginant une cité au bord de l’insurrection, où le vivre-ensemble semble totalement éclaté, noyé sous la défiance et la colère.
Ces tensions trouvent aussi un écho dans la satire : Problèmos (2017, écrit par Noé Debré et Blanche Gardin) décortique avec ironie les contradictions d’un idéal communautaire, où l’utopie d’un vivre-ensemble autogéré se heurte aux réalités des conflits internes et des égos. Le film illustre avec brio comment le « vivre ensemble » peut rapidement se déliter lorsqu’il est mis à l’épreuve par les failles humaines. Comme le souligne le sociologue Jean Viard :
« Les récits fictionnels sont des lieux où se construisent les imaginaires du collectif, confrontant les tensions entre individualisme et solidarité. »
Jean Viard, Le Sacre du temps libre, 2002
Et en 2050, à quoi ressemblera le vivre ensemble ?
2050 : imaginer le vivre ensemble dans un monde globalisé
« Les crises planétaires exigent de repenser le vivre ensemble à une échelle globale, tout en préservant les particularités locales. »
Frédéric Gemenne, Géopolitique du climat (2015)
Dans un futur marqué par les crises climatiques et la mondialisation, les récits pourraient explorer des formes inédites de coexistence. Quelles formes prendrait la cohabitation dans un monde où les habitats partagés deviendraient la norme, ou où les interactions virtuelles remplaceraient les liens physiques ?
Les scénaristes auront un rôle clé à jouer dans la construction de ces imaginaires. Comment représenter des sociétés où la solidarité dépasse les frontières nationales ? Quels récits permettront de naviguer entre utopie et dystopie, en montrant les défis d’un vivre ensemble dans un monde hyperconnecté mais parfois déshumanisé ?