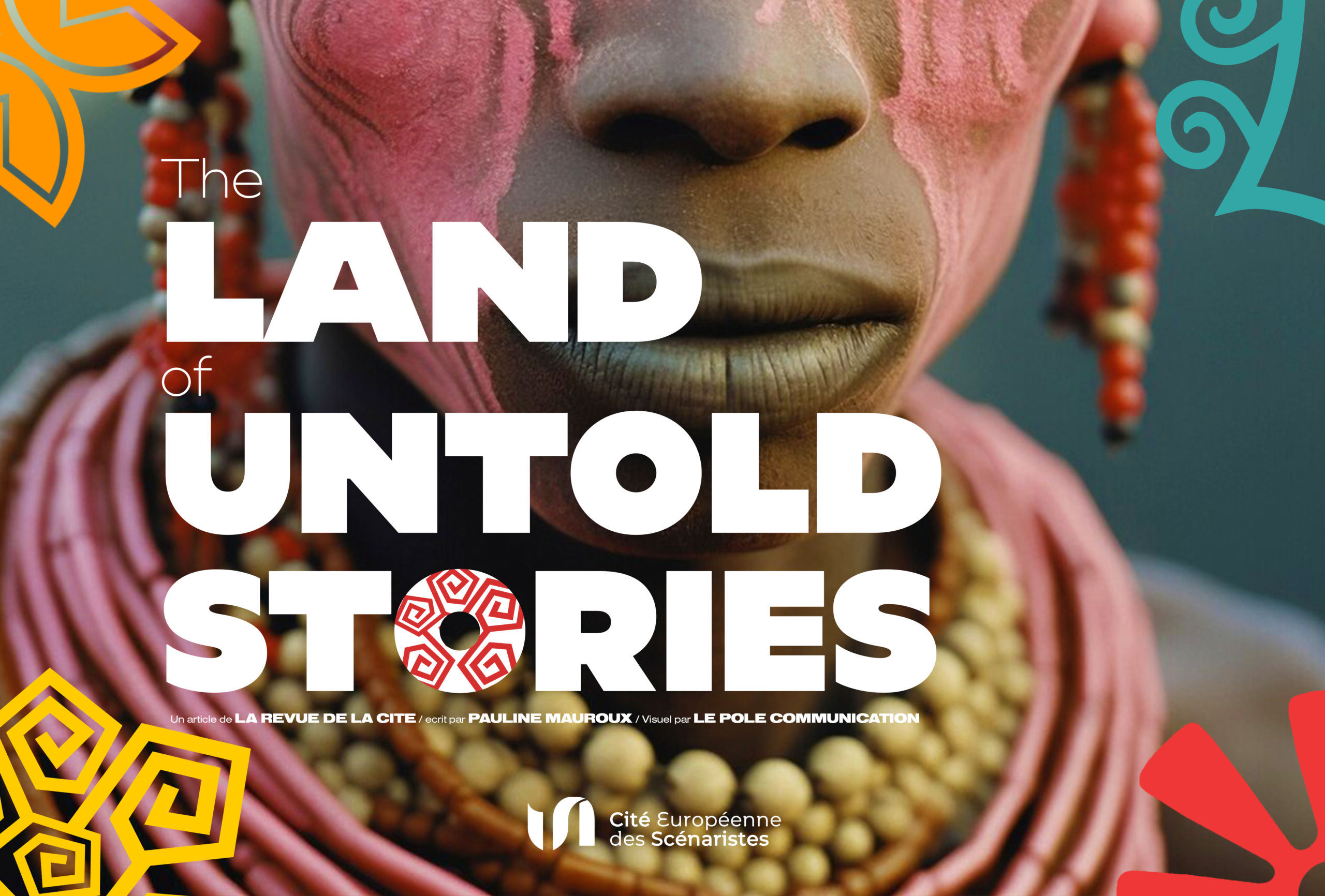« L’Afrique est encore un bébé en termes d’industries d’animation et de création. (…) Mais les histoires que nous racontons, et la manière dont nous les racontons, sont différentes. C’est littéralement le pays des histoires inédites, n’est-ce pas ?”
Ces propos rapportés par Statement Africa sont ceux de Abdulrahman Khedr, le PDG de Giraffics, le studio d’animation égyptien qui a travaillé sur l’anthologie de courts-métrages de Disney +, Kizazi Moto: Generation Fire, dont nous parlions dans le premier article de cette série.
La nouvelle génération de scénaristes d’animation veut changer ce manque de représentation, en accordant autant d’importance à la direction artistique qu’aux histoires racontées et aux langues utilisées.
Retour sur les récits qui animent les talents de l’animation en Afrique, à travers des œuvres qui célèbrent la diversité linguistique et culturelle, l’héritage historique, et explorent les problèmes contemporains auxquels fait face le continent.
Un outil de préservation des contes et dialectes locaux
Des 7 000 langues et dialectes parlés sur la planète, à peu près 2 500 le sont en Afrique, soit un tiers du nombre mondial.
En 2018, un rapport de l’UNESCO indiquait que 300 langues du continent africain étaient en danger d’extinction, soit 12%, et que 52 étaient d’ores et déjà mortes. Une des explications étant que la plupart des gouvernements n’autorisent plus l’apprentissage des langues dites “non-officielles” à l’école.
Face à cet effacement annoncé, les talents africains se mobilisent.
La journaliste, poétesse et écrivaine kenyane Njeri Wangari crée et dirige AfroKidz, un studio de création digitale destiné à préserver les folklores des contes africains pour enfants et à promouvoir l’utilisation des dialectes africains au quotidien.
Elle explique dans cet article de Global Voices :
“L’animation est devenue un outil de préservation des langues africaines en voie de disparition. Grâce au divertissement, (…) l’animation [devient] véhicule des mythologies, philosophies, riches traditions, expressions culturelles et langues africaines.”
Voici quelques exemples de séries d’animation qui font (re)vivre les langues africaines :
- Bino et Fino, le dessin animé éducatif pour enfants créé par l’animateur nigérian Adamu Waziri.
Les personnages – Bino et Fino – sont un frère et une sœur qui apprennent l’histoire, les langues et les cultures du continent avec Zeena, un papillon magique. Le dessin animé est diffusé dans 15 pays en anglais, twi, yoruba, allemand, néerlandais, portugais, haoussa, igbo, français et swahili et est également disponible sur YouTube.
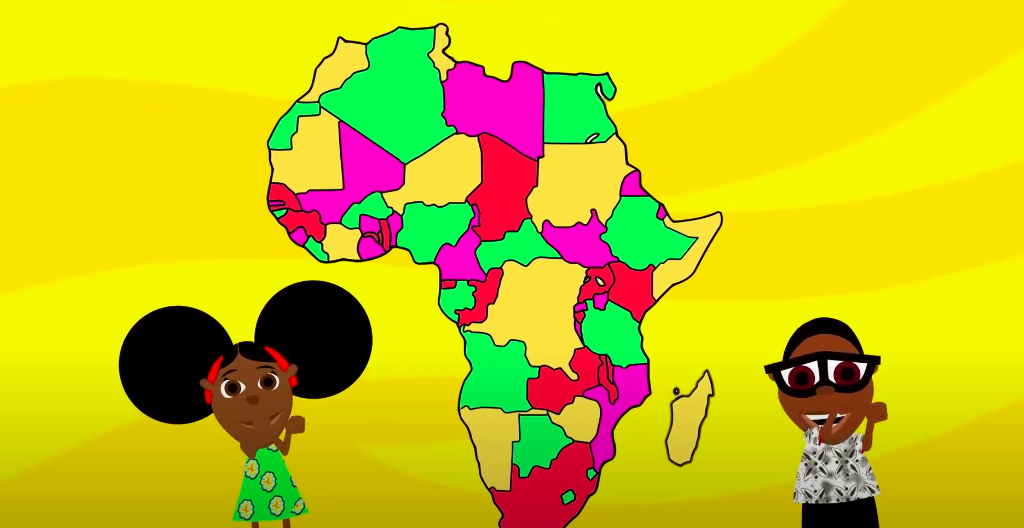
- Ebi Folorunso est une autre série d’animation diffusée sur YouTube, qui enseigne, elle, la langue yoruba couramment parlée au Nigeria.
Créée par Kayode Oloko, un Finno-Nigérian, la série fait campagne pour sensibiliser à la culture, aux traditions, à la langue et à l’identité de tous les enfants yorubas du Nigeria.
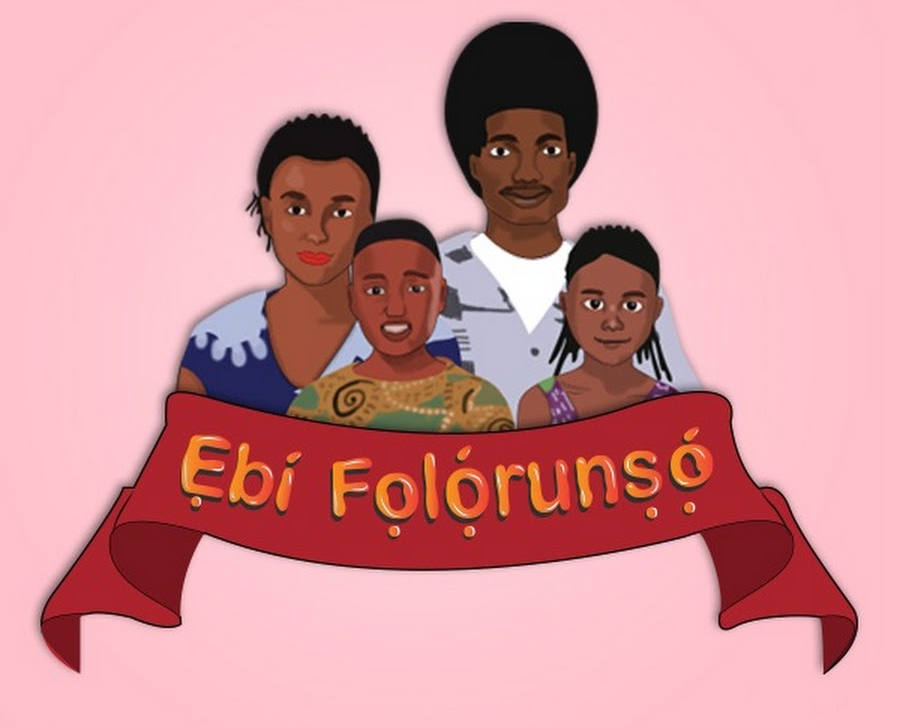
- Outre la série de 2003 Kabongo, d’autres récits d’animation s’inspirent des contes et mythologies locales, comme la série kenyane Les Contes de Tinga Tinga (2010).
Nommée d’après l’école d’art tanzanienne Tingatinga, la série s’inspire des contes animaliers d’Afrique de l’Est et explique avec imagination pourquoi les animaux sont comme ils sont. Elle a été diffusée sur France 5 entre 2011 et 2012.
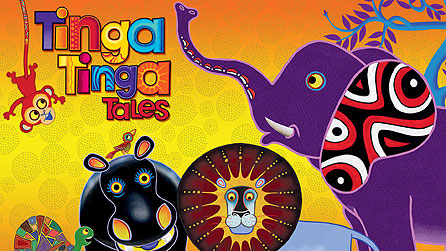
- La Légende de Lwanda Magere (2020) est un court-métrage d’animation du Kenyan Kwame Nyong’o.
Il raconte l’histoire héroïque de Lwanda Magere, un guerrier surhumain à la peau de pierre et à la force de dix hommes. Cette adaption du conte éponyme folklorique kenyan, traditionnellement transmis par voie orale, permet sa préservation et sa diffusion grâce aux techniques de l’animation.
Réappropriation de l’héritage collectif
L’animation africaine explore également l’Histoire du continent dans des histoires racontées du point de vue africain.
Le studio sud-africain Dynamic Africa produit en 2018 I Am Khama, l’histoire de la campagne menée par le roi Khama III en 1895 pour protéger le Bechuanaland (aujourd’hui le Botswana) du pillage continu de l’impérialiste britannique Cecil John Rhodes.
Pour le studio, de tels scénarios sont primordiaux pour réécrire l’Histoire du point de vue de ceux dont les expériences ont été effacées et reléguées aux marges, plutôt que sous l’angle dominant jusqu’à présent, celui des oppresseurs :
« Des récits comme celui-ci sont peut-être bien connus dans des pays comme le Botswana, mais pour beaucoup de gens au Royaume-Uni, ils sont inconnus.”

Petit tour d’horizon de ces récits remettant en lumière l’héritage historique du continent :
- Malika: Warrior Queen (2019), produit par le studio nigérian Anthill, est un court-métrage adapté de la bande-dessinée du créateur Roye Okupe.
Le scénario se déroule au XVe siècle en Afrique de l’Ouest et raconte l’histoire d’une reine qui lutte pour maintenir la paix dans son empire en pleine expansion. Après des années de guerre civile, elle divisa le royaume d’Azzaz en deux avant de le reconquérir. Cette histoire est largement inspirée de la reine Amina de Zaria qui vécut au XVIe siècle et régna sur le nord-ouest du Nigeria.
Produite pour 60 000 $, Malika: Warrior Queen a reçu un bel accueil, notamment pour sa manière de célébrer l’histoire africaine et une adaptation en long-métrage est en discussion.
- La Légende la princesse Yennenga est un court-métrage du collectif HomeTeam History. Il raconte la légende de celle qui s’est battue pour échapper aux bras d’un père autoritaire dans la quête de son propre destin, et qui a établi un nouveau royaume qui allait devenir le Burkina Faso. HomeTeam History finance en partie ses projets sur la plateforme Patreon.
L’histoire récente et les traumatismes collectifs du XXe siècle commencent également à être abordés par les talents de l’animation sous des formes plus expérimentales.
On peut par exemple citer le documentaire animé Beyond Freedom (2006), réalisé par Jacquie Trowell (l’une des fondatrices du studio sud-africain Triggerfish), qui est une réflexion collective de Sud-Africains qui ont vécu l’Apartheid.
Miroir de l’urgence écologique et climatique
En matière de récits écologiques, les talents africains reprennent également la main, comme l’explique le co-créateur de la série animée Isaura, Andrew McNally, à CBR en 2020 :
“Les Africains sont souvent présentés dans les médias comme des victimes de la pauvreté et des catastrophes environnementales (…). Nous avons donc pensé qu’il était grand temps d’avoir une série unique dans la mesure où la protagoniste vient d’Afrique, qu’elle est un personnage féminin jeune et fort, et qu’elle prend à bras-le-corps cette question massive de la conservation, aussi jeune et insignifiante qu’elle puisse se sentir – mais qu’elle la prend à bras-le-corps.”
Isaura (en développement) est une série d’animation du studio sud-africain Lucan qui raconte l’histoire d’Isaura, une jeune fille d’un village de pêcheurs du Mozambique, qui devient la première gardienne humaine depuis des siècles chargée de protéger l’océan, les tortues, et de rétablir le lien entre les humains et les animaux.
Vous pouvez retrouver ici le processus créatif du réalisateur Andrew McNally derrière la bande-annonce ci-dessous.
On peut également citer d’autres oeuvres se concentrant sur les problématiques écologiques du continent :
- The Oil of Amadi (2020) du Sud-Africain Matthew Brown et Nigérian Harrison Yinfaowei, présenté au Festival international du film d’animation d’Annecy de 2020, qui raconte les conséquences d’un choc pétrolier et d’une marée noire pour la petite Amadi, 9 ans, qui vit dans un village flottant nigérian.

- Garbage Boy and Trash Can (2017) du Nigérian Ridwan Moshood est une série d’animation diffusée sur Cartoon Network qui éduque les enfants sur l’importance de la responsabilité environnementale et du recyclage. Cette série est la première série nigériane diffusée sur Cartoon Network.

Le créateur de la série Ridwan Moshood, 31 ans, est un auto-didacte complet. Il raconte à Kidscreen :
« Il n’y avait pas beaucoup d’écoles d’animation abordables au Nigeria auxquelles je pouvais m’inscrire. J’ai appris en regardant les classiques de Cartoon Network à la télévision et en faisant des tutoriels sur YouTube. Je n’avais même pas d’ordinateur portable pour m’entraîner; je devais utiliser les cybercafés de Lagos.”
Avec des scénaristes aussi déterminés, pleins de ressources, ambitieux et talentueux, l’animation africaine a de (très) beaux jours devant elle.