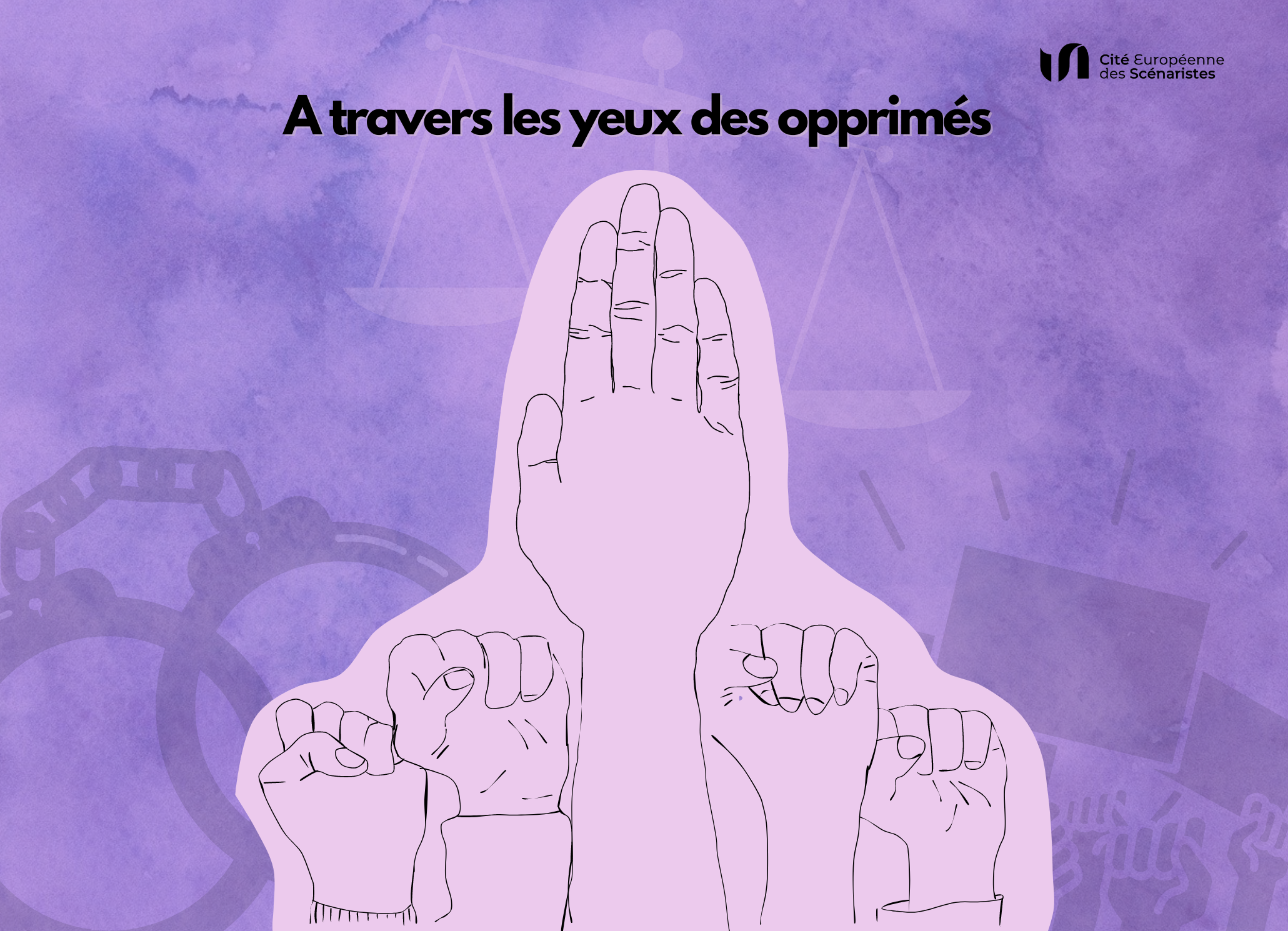En se réappropriant le passé
Si Winston Churchill disait que “L’Histoire est écrite par les vainqueurs”, les scénaristes réinventent la politique en donnant une voix à celles et ceux qui ont été opprimé·es et oublié·es.
Ainsi, des pans entiers de l’histoire sont remis en lumière et participent à cette nécessité de réécrire la partie qui a trop longtemps été occultée par les “vainqueurs”.
On peut citer par exemple :
- le rôle des tirailleurs algériens et goumiers marocains lors de la Seconde Guerre mondiale avec Indigènes (2006), écrit par Rachid Bouchareb et Olivier Lorelle
- les contributions importantes de femmes afro-américaines à la NASA pendant les débuts de la course spatiale avec Les Figures de l’ombre (2016), écrit par Theodore Melfi et Allison Schroeder
- l’esclavage du point de vue d’un homme kidnappé et mis en esclavage pendant 12 ans avec 12 Years a Slave (2013), écrit par John Ridley, adapté des mémoires éponymes de Solomon Northup écrits en 1853
En donnant une voix aux marginalisés
Donner une voix à celles et ceux qui sont marginalisé·es n’est pas l’apanage des récits historiques ; c’est également une nécessité contemporaine.
Robin Campillo disait en 2018 dans cette interview au Guardian :
“Quand on change le point de vue, on change le cinéma.”
Quand on change le point de vue, on peut également souligner les manquements des actions politiques et rééquilibrer la société.
On peut citer ces exemples français de récits qui ont donné une voix aussi bien aux zones péri-urbaines :
- La Haine (1995), écrit par Matthieu Kassovitz
- Bande de Filles (2014), écrit par Céline Sciamma
- Divines (2016), écrit par Houda Benyamina, Romain Compingt, Malik Rumeau
- Les Misérables (2019), écrit par Giordano Gederlini, Ladj Ly et Alexis Manenti
- Grand Paris (2022), écrit par Martin Jauvat
… Qu’aux zones rurales :
- Médecin de campagne (2016), écrit par Thomas Lilti, Shérazade Khalladi et Baya Kasmi, qui parle des déserts médicaux ruraux
- Petit Paysan (2017), écrit par Hubert Charuel et Claude Le Pape
En inspirant au militantisme
Quand les instances politiques protègent les intérêts des plus offrants, empêchent tout forme de liberté d’expression ou bien n’endossent pas son rôle de protectrices de leurs citoyens, il ne reste plus qu’à monter au combat.
Ce militantisme peut s’incarner soit par la force du groupe, soit par la volonté d’une individualité.
Inspirée de faits réels, cette narration sociale retrace les luttes politiques à travers des expériences collectives… :
- la marche pacifiste de 1983 contre les violences racistes ayant tué le jeune Mohamed : La Marche (2013), écrit par Nabil Ben Yadir, Nadia Lakhdar et Ahmed Ahmidi
- l’alliance d’activistes LGBT pour aider la grève des mineurs britanniques de 1984-1985 : Pride (2014), écrit par Stephen Beresford
- la structuration du mouvement des droits civiques américains en 1965 : Selma (2014), écrit par Paul Webb
- l’histoire de ces femmes qui se sont battues pour avoir accès au droit de vote : Les Suffragettes (2015), écrit par Abi Morgan
- le combat de l’association Act-Up contre l’indifférence générale des pouvoirs publics : 120 Battements par minute (2017), écrit par Robin Campillo et Philippe Mangeot
… Et des expériences individuelles :
- le combat de Norma Rae dans les années 70 pour créer un syndicat dans une usine : Norma Rae (1979), écrit par Harriet Frank Jr. et Irving Ravetch d’après le livre Crystal Lee: A Woman of Inheritance de Henry Leiferman
- le combat de Karen Silkwood, une ouvrière dans une usine de plutonium, qui va se battre contre la négligence de la société et pour des conditions de travail moins dangereuses : Silkwood (1983), écrit par Nora Ephron et Alice Arlen
- le combat d’Erin Brokovich contre le scandale des eaux polluées d’une petite ville : Erin Brokovich, seule contre tous (2000), écrit par Susannah Grant
- le combat d’Irène Frachon contre les intérêts pharmaceutiques : La Fille de Brest (2016), écrit par Emmanuelle Bercot, Romain Compingt et Séverine Bosschem